Exposition réalisée par les services d'Universcience, librement téléchargeable et imprimable. © Universcience mars 2020
0
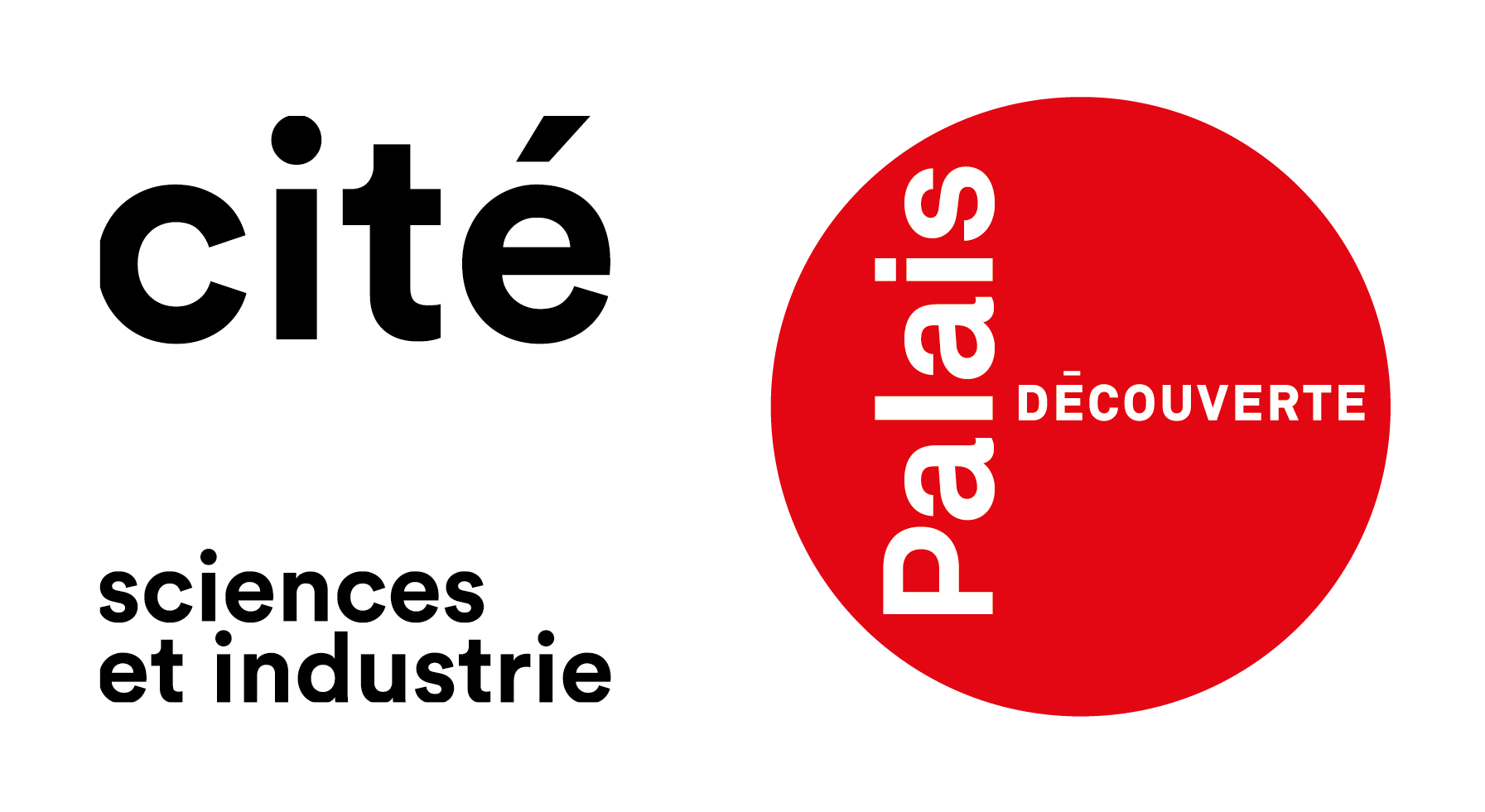
0
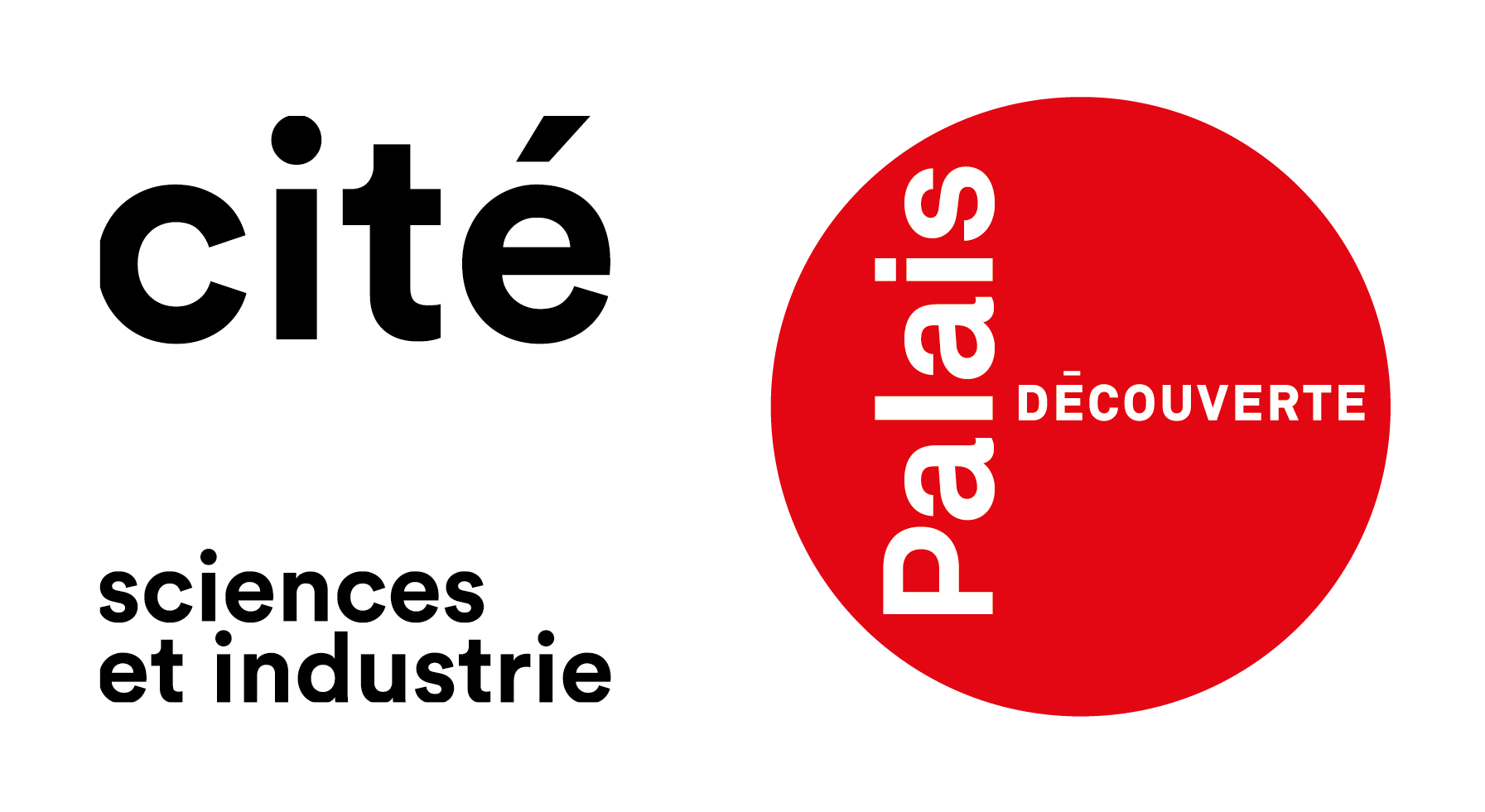
Exposition réalisée par les services d'Universcience, librement téléchargeable et imprimable. © Universcience mars 2020
U. Vaccin atténué, inactivé, sous-unitaire, à vecteur ou à ARN, quelles différences ?
©Photo by Justin Tallis/POOL/AFP
Vacciner consiste à mettre en contact le corps avec un morceau du pathogène de façon que le système immunitaire garde une mémoire de cette rencontre et agisse rapidement et efficacement contre le microbe entier lors d’une rencontre ultérieure (voir questions F et P). Mais quel morceau choisir ? Grâce au séquençage rapide du génome du SARS-CoV-2 et aux études sur d’autres coronavirus, on a pu identifier la cible idéale. Il s’agit de la molécule de surface S, celle qui donne au virus cet aspect hérissé de piquants. L’étape suivante consiste à présenter correctement à l’organisme cette protéine S qui ne peut, à elle seule, déclencher la maladie. Pour ce faire, différentes techniques existent, chacune avec ses atouts et ses limites. En voici quelques-unes.
C’est l’un des plus anciens procédés. Il consiste à inoculer le microbe entier privé de son caractère pathogène. Il contient évidemment la protéine S et stimule donc le système immunitaire. Ces vaccins vivants atténués sont déconseillés aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Celles-ci sont en effet moins aptes à lutter contre des microbes qui bien qu’atténués se multiplient encore.
C’est le principe du vaccin combiné contre les trois infections rougeole, oreillons et rubéole (ROR).
Société mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Codagenix, associée au Serum Institute of India.
Il s’agit d’injecter uniquement l’antigène cible. On inocule donc la protéine S ou une partie de cette protéine, synthétisée en laboratoire. C’est la technique la plus utilisée dans les différents essais de vaccin contre la Covid-19. Elle est réputée d’autant plus sûre qu’elle ne comporte pas le virus entier. Mais elle nécessite l’ajout d’adjuvants dans le vaccin pour que le système immunitaire réagisse.
C’est le principe des vaccins contre la coqueluche, la méningite à méningocoque et l’hépatite B.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Novavax d’une part et Sanofi Pasteur associé à GlaxoSmithKline (GSK) d’autre part.
Le principe est ici de faire produire des protéines S par nos propres cellules. Pour ce faire, le vaccin contient une molécule appelée ARN messager (ARNm), enfermée dans une petite vésicule constituée de lipides. Après injection, celle-ci fusionne avec la membrane des cellules et y libère l’ARNm. Une machinerie présente naturellement dans les cellules suit alors les instructions contenues dans l’ARNm et produit des protéines S, mais de manière transitoire, car l’ARNm est une molécule qui se dégrade rapidement. Outre la rapidité et une certaine simplicité de fabrication, ce type de vaccin ne nécessite pas l’ajout d’adjuvant car la molécule d’ARNm joue elle-même ce rôle permettant la mise en place d’une réponse immunitaire forte et spécifique.
Aucun vaccin de ce genre n’était utilisé auparavant.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Pfizer et BioNTech d’une part et Moderna d’autre part.
Au lieu d’introduire directement la protéine S, cette méthode consiste à modifier un virus inoffensif pour l’homme de façon que sa surface comporte des protéines S. Ce virus joue le rôle d’un transporteur, on parle de vecteur viral. En transportant la protéine S dans l’organisme, il déclenche contre elle une réponse immunitaire.
C’est le principe du vaccin contre Ebola.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : AstraZeneca d’une part et CanSino Biologics associé à Beijing Institute of Biotechnology d’autre part.
Cette fois, l’agent infectieux est incapable d’engendrer des symptômes et de se multiplier. Bien toléré chez des personnes immunodéprimées, cette vaccination mime moins bien l’infection. L’immunité est moins performante. Voilà pourquoi plusieurs injections – ou rappels – sont nécessaires. L’ajout d’un adjuvant dans la composition vaccinale permet de compenser la moindre activation de nos défenses.
C’est le principe du vaccin contre la poliomyélite.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Sinovac Biotech d’une part et Beijing Biological Products Institute d’autre part.
Vaccin vivant atténué
Vaccin sous-unitaire
Vaccin à ARN
Vaccin à vecteur
Vaccin inactivé
Infirmière et patient s’apprêtant à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 en décembre au Pays de Galles.

informations mises à jour le 14/01/2021

T. Pourquoi le sida et le paludisme n’ont-ils pas leurs vaccins ?
Moins d’un an après l’apparition de la maladie, plusieurs vaccins contre le SARS-CoV-2 existent. Le sida, dont le virus a été découvert en 1983, n’en a toujours pas. Le paludisme non plus. L’explication tient dans les particularités des agents infectieux responsables de ces maladies.
La mise au point d’un vaccin rencontre moins d’obstacles si le microbe varie très peu et stimule efficacement le système immunitaire. Le SARS-CoV-2 est de ceux-là, contrairement au parasite responsable du paludisme et au virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Le système immunitaire ne reconnaît pas un microbe dans son ensemble mais des petites parties, caractéristiques et immuables. En ciblant ces parties, il détruit le microbe. Malheureusement ces parties changent dans le virus du sida. Les erreurs se multiplient au moment de sa réplication et produisent des virus différents. Cette extrême variabilité est le principal obstacle à un vaccin qui cible un microbe précis, c’est-à-dire très peu variable. L’espoir viendra peut-être des recherches qui se focalisent sur les parties les plus stables du virus, bien que celles-ci induisent une faible réponse immunitaire.
Quant au paludisme, il est dû à un parasite qui est transmis à l’homme à l’occasion d’une piqûre de moustique. Injecté dans le sang, ce parasite infecte les cellules du foie. Après quelques jours, il infecte des globules rouges puis se retrouve dans le sang. Il peut ainsi passer à un nouveau moustique à l’occasion d’une autre piqûre. À chaque étape il se multiplie et adopte des formes très différentes. En particulier, les protéines présentes à sa surface varient beaucoup d’une phase à l’autre. Or ce sont justement ces protéines que le système immunitaire, et donc un éventuel vaccin, visent. Comme pour le sida, cette polymorphie est un écueil majeur à l’élaboration d’un vaccin.
En outre, pour le paludisme comme pour le sida, le vaccin ne devra pas mimer la réponse immunitaire mais l’améliorer. Car, pour ces deux maladies, les réactions immunitaires existent mais ne parviennent pas à éliminer les microbes.
© Victoria Jones / POOL / AFP
Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Grande–Bretagne, décembre 2020

informations mises à jour le 14/01/2021


S. Mais où est passé le pangolin ?
L’origine du SARS-CoV-2 demeure mystérieuse. On a soupçonné le pangolin d’avoir joué le rôle d’intermédiaire permettant au virus d’infecter l’humain. Est-il toujours le principal suspect ?
96 % : c’est le taux de ressemblance entre le génome du SARS-CoV-2 et celui d’un autre coronavirus présent chez une espèce de chauve-souris vivant en Chine. Voilà qui accrédite l’hypothèse d’une émergence (voir question I), en l’occurrence le passage du virus de la chauve-souris à l’espèce humaine.
Cependant, ce virus de chauve-souris ne peut infecter directement les cellules humaines : sa protéine de surface (S) est trop différente de celle qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules.
C’est là qu’intervient le pangolin. Car on a trouvé, chez certains spécimens, un coronavirus qui possède un gène capable de produire des protéines S très similaires à celles du SARS-CoV-2.
À partir de cette similarité, des chercheurs ont alors imaginé le scénario suivant : un pangolin porteur de ce coronavirus se retrouve également infecté par le coronavirus de la chauve-souris. Les deux virus se recombinent, prouesse courante dans cette famille de virus. Résultat : après être passé par cet animal, le nouveau virus recombiné possède le gène qui code la bonne protéine S.
Mais les ressemblances se sont révélées trompeuses.
La portion génétique du coronavirus trouvé chez le pangolin est trop différente de celle qui permet de produire la protéine du SARS-CoV-2.
Et c’est en fait un virus identique à 99 % (et non 96 %) qui pourrait accéder au titre de plus proche ancêtre du SARS-CoV-2. Les analyses de biogénétique ont montré que le virus responsable de la Covid-19 ne descend pas en droite ligne des coronavirus déjà trouvés chez la chauve-souris. Ils sont cousins, puisqu’il faut remonter au moins quarante ans en arrière pour trouver leur ancêtre commun. Et même cousins éloignés ! Le virus dont découle le SARS-CoV-2, juste avant qu’il n’infecte l’espèce humaine, est donc encore à découvrir. Et l’hôte qui l’héberge peut être un pangolin ou un tout autre mammifère.
© Roland Seitre / Minden Pictures / Biosphoto
Femelle pangolin et son petit, appartenant à l’espèce un temps suspectée : le Pangolin de Malaisie (Manis janavica)
informations mises à jour le 14/01/2021

Concevoir un nouveau médicament est un processus très long. Face à l’urgence sanitaire liée à la Covid-19, les chercheurs du monde entier se sont tournés vers des médicaments antiviraux déjà utilisés contre d’autres pathologies. On parle de repositionnement. Mais pour l’heure, les résultats sont décevants.
Seul un antiviral utilisé contre le VIH réduit de quelques jours le temps passé à l’hôpital par les patients atteints de la Covid-19 : le remdesivir. En revanche, il ne démontre pas d’effet sur la mortalité. Ce médicament agit sur une protéine virale dont le rôle est de copier le matériel génétique du virus, nucléotide après nucléotide. Le remdesivir est un analogue de l’un de ces nucléotides, qui, une fois incorporé dans la chaîne fraîchement constituée, la bloque. La réplication du virus devrait être ainsi empêchée… mais dans le cas du SARS-CoV-2, elle est seulement réduite. Cette efficacité décevante est sans doute due à une particularité des coronavirus : ils possèdent une protéine capable de détecter et retirer les erreurs introduites dans la copie en cours de production.
Puisque les médicaments déjà connus manquent d’efficacité contre la Covid-19, il faut en concevoir de nouveaux. La méthode consiste à bien connaître les cibles susceptibles de bloquer le développement du virus (voir question Q). C’est ainsi que les chercheurs ont déterminé la structure tridimensionnelle de plusieurs protéines virales, soit la façon dont les atomes sont liés les uns aux autres dans l’espace et forment ces énormes molécules. Ils modélisent ensuite in silico, c’est-à-dire informatiquement, la fixation entre des molécules candidates et une de ces protéines virales pour choisir celles qui pourraient inhiber le mieux son activité. Ce préliminaire numérique pourrait permettre de gagner du temps dans la sélection de molécules à synthétiser et à tester ensuite in vitro et in vivo.
R. Comment chercher un antiviral contre le SARS-CoV-2 ?

Analyse Nicola De Maio, image logiciel ICM (Molsoft). Source DOI : 10.5281/zenodo.4041302
Représentation en 3D d’une protéine du SARS-CoV-2 (en gris) et du blocage de son activité par la fixation de l’antiviral remdesivir.
informations mises à jour le 14/01/2021

Q. Pourquoi les traitements contre les virus sont-ils très différents de ceux contre les bactéries ?
Les bactéries sont des organismes vivants, généralement constitués d’une seule cellule. Elles possèdent les éléments nécessaires pour se nourrir, respirer et engendrer une descendance dès lors qu’elles se trouvent dans un milieu adapté. Les traitements médicaux contre les bactéries consistent donc à les empêcher de se multiplier ou à les tuer en ciblant ces éléments. C’est l’action des antibiotiques. Pour les virus, cette méthode ne fonctionne pas. En effet, les virus ne peuvent se reproduire que s’ils parviennent à pénétrer dans une cellule du corps dont ils vont monopoliser les ressources pour se répliquer. Il ne s’agit donc plus de tuer une cellule autonome mais, au contraire, de préserver une cellule hôte tout en bloquant le cycle du virus qui la parasite. Et ce n’est pas chose aisée. C’est pourquoi les traitements se limitent le plus souvent à soulager les symptômes en attendant que le virus soit éliminé par le système immunitaire. Le VIH et le virus de l’hépatite C, qui provoquent des maladies chroniques, font pourtant exception : des traitements dits « antiviraux » particulièrement efficaces ont été mis au point. Il s’agit de bloquer l’une des étapes du cycle de ces virus, dont le point commun est d’avoir un génome à ARN, molécule légèrement différente de l’ADN.
Pour les coronavirus, le cycle de reproduction débute avec la phase d’attachement. Les spicules, situés à la surface des virus, se fixent à certains récepteurs des cellules pulmonaires (voir question H). Cela déclenche l’entrée du virus (endocytose) et aboutit, notamment, à la libération de son matériel génétique à l’intérieur de la cellule. Il va alors tirer avantage des ressources à disposition dans cette dernière. On parle de détournement. Au lieu de fabriquer des éléments pour la cellule, les acteurs de celle-ci se mettent à produire deux types de protéines virales (traduction) à partir du génome ARN de l’intrus. Ces protéines sont capables de se scinder pour former de plus petites protéines ayant différents rôles (clivage). Certaines s’associent et entreprennent notamment de copier le génome viral en de multiples exemplaires. C’est la réplication. Petit à petit, tous les constituants sont produits et s’assemblent pour former de nouveaux virus qui sortent de la cellule, soit discrètement (exocytose), soit en la détruisant.
C’est pourquoi, afin de s’attaquer aux protéines virales tout en préservant la cellule hôte, la recherche d’antiviraux contre les coronavirus suit trois pistes : empêcher la phase d’attachement en ciblant le spicule, bloquer le clivage des protéines ou bloquer leur réplication.

©Cordelia Molloy/Science Photo Library/Jounaid Mihoubi-Universcience
Cycle de reproduction du virus SARS-CoV-2 dans une cellule
informations mises à jour le 14/01/2021

P. Sans anticorps, notre corps peut-il se défendre ?
Les anticorps sont, à n’en pas douter, un mode d’action clé de notre système immunitaire pour faire face aux multiples intrusions microbiennes. Pour autant, ces protéines ne sont pas nos seules forces de défense. Parmi les autres dispositifs à l’œuvre, la réponse dite cytotoxique est particulièrement importante pour lutter contre des virus et peut constituer un type de mémoire immunitaire efficace pour protéger l’organisme à plus long terme, même lorsqu’il y a très peu d’anticorps.
L’étymologie du mot le laisse entendre (« cyto » signifie cellule), la réponse cytotoxique est nocive pour certaines cellules, notamment celles qui sont infectées. Elle fait intervenir un type de globules blancs, appartenant à la famille des lymphocytes T, capables de reconnaître des cellules atypiques, comme les cellules infectées, et de provoquer leur destruction. C’est au cours d’un contact rapproché, parfois appelé « baiser de la mort », que ces lymphocytes déversent sur leur cible des granules remplies de molécules toxiques. Ce sont, par exemple, les perforines, qui percent la membrane de la cellule infectée, entraînant sa destruction par un processus de dissolution chimique appelé lyse. D’autres molécules déclenchent un programme d’autodestruction de la cellule appelé apoptose. Ce mode d’action intervient en particulier lorsqu’un virus a déjà envahi une cellule pour s’y multiplier et qu’il se trouve alors insensible à l’action des anticorps.
Notre système immunitaire déploie donc une combinaison de dispositifs complémentaires, adaptée à la nature de chaque agent pathogène, leur nombre et leur virulence. Comme pour la production d’anticorps, la réponse cytotoxique nécessite quelques jours avant d’être opérationnelle la première fois. Elle peut constituer ensuite un groupe de cellules prêtes à agir plus vite et plus efficacement en cas de réinfection par le même agent pathogène, et ce même lorsqu’il y a très peu d’anticorps. La mise en place d’une telle mémoire immunitaire est l’un des objectifs recherchés lorsque l’on met au point un vaccin contre un virus. Moins évident à détecter expérimentalement que la présence d’anticorps, le développement d’une bonne réponse cytotoxique est un enjeu manifeste face au virus SARS-CoV-2 sur lequel travaillent nombre de chercheurs.

Un lymphocyte T tueur (en bleu) s'apprête à détruire sa cellule cible (en haut, en vert) grâce à des granules toxiques (rouges).
©NICHD/ J. Lippincott-Schwartz
informations mises à jour le 14/01/2021


O. Pourquoi certains cas de Covid-19 sont-ils graves ?
Chez certains patients, la Covid-19 présente des formes particulièrement sévères. On assiste, chez eux, à un affolement de la réponse immunitaire, cette réaction pourtant chargée de lutter contre les infections.
Lors d’une infection, des globules blancs aptes à détruire les virus et les cellules infectées migrent vers la zone malade. Cet afflux est régulé grâce à des protéines appelées cytokines. Avec le SARS-CoV-2 on constate une surproduction de cytokines. On parle d’« orage cytokinique ». La réponse immunitaire s’emballe. Elle détruit alors davantage les cellules qu’elle ne les défend.
La survenue de cet événement serait favorisée par un système immunitaire moins réactif aux nouvelles infections, comme celui des sujets âgés. Les pathologies chroniques comme l’obésité, certaines atteintes cardiovasculaires ou respiratoires, l’insuffisance rénale, le diabète favorisent aussi cette séquence d’événements. Ces maladies se caractérisent par l’arrivée constante de globules blancs et l’activation continuelle de cytokine dans les organes malades. Ces particularités expliqueraient la grande facilité du système immunitaire à s’emballer.
Cependant, des individus relativement jeunes, dont quelques enfants, ont présenté des formes graves de la maladie en l’absence de ces facteurs. Voilà ce qui pousse les chercheurs à identifier les autres paramètres aggravants.
À ce titre, le consortium international Covid Human Genetic Effort (Covid HGE) analyse l’ADN complet de patients. Ces travaux ont révélé, chez 3 % des patients gravement atteints, une défaillance particulière d’origine génétique : l’impossibilité complète de produire l’interféron (voir question N).
Une faible production d’interféron est couramment observée dans la Covid-19. Pour certains chercheurs, la maladie est d’autant plus grave que l’interféron fait défaut.
Le consortium a d’ailleurs découvert que 10 % des patients gravement atteints (très majoritairement des hommes âgés) synthétisent des anticorps dirigés contre leurs interférons, neutralisant ainsi malheureusement leur action. Ce problème pourrait être résolu en leur administrant un autre type d’interféron.
© SPL / PHANIE
informations mises à jour le 14/01/2021


N. Comment peut-on être porteur du virus et ne pas avoir de symptômes ?
Molécule d’interféron humain. Cette protéine joue un rôle important dans la réponse immunitaire initiée contre le virus.
©theasis/E+/Getty Images
Très tôt, on a soupçonné que l’épidémie de Covid-19 était plus étendue que ce que montrait la détection des signes cliniques confirmés par un dépistage du SARS-CoV-2. Il existe effectivement une part silencieuse de l’épidémie : les infections asymptomatiques (pas de symptômes) et paucisymptomatiques (peu de symptômes). Cela semble être le cas pour la plupart des enfants.
L’une des raisons de cet état de fait est qu’il se joue, au sein de chaque hôte, une véritable course de vitesse entre le virus et la réponse immunitaire. Le résultat de cette course influence fortement l’issue de l’infection et l’intensité des symptômes associés. Dès les premières heures, lorsque le virus est entré dans les cellules de l’arbre respiratoire et a commencé de s’y répliquer, une réponse antivirale est enclenchée. Une cellule infectée est, par exemple, capable de détecter seule la présence d’un génome viral dans son cytoplasme. Elle se met alors à produire diverses molécules comme les interférons de type 1, dont un des rôles est de bloquer en partie le mécanisme de traduction à l’œuvre dans la cellule, la mettant ainsi presque à l’arrêt. La cellule limite alors sa propre capacité à fabriquer des protéines indispensables à son bon fonctionnement, mais empêche surtout la réplication du virus, qui dépend aussi de ce processus. La cellule n’est plus au service du virus et, en sécrétant l’interféron, transmet même le message d’alerte aux cellules avoisinantes, qui reproduisent à leur tour ce mécanisme de blocage. Si la réponse est suffisamment vigoureuse, et l’on pense que c’est par exemple le cas chez les enfants, la réplication virale peut être arrêtée avant l’apparition d’effet massif dû au virus. Pendant quelques heures à quelques jours, une personne peut ainsi être infectée mais ne présenter aucun ou peu de symptômes. Indépendamment de la gravité des symptômes, s’il y en a, les personnes infectées sont potentiellement contagieuses.
Malheureusement, et c’est probablement le cas du SARS-CoV-2, les coronavirus possèdent des armes qui ralentissent fortement la réponse antivirale et, notamment, l’action bénéfique de l’interféron au stade précoce de l’infection. Une des voies de recherche consiste aujourd’hui à comprendre comment le virus réduit l’action de l’interféron afin d’y remédier.
informations mises à jour le 14/01/2021

M. Hors de son hôte, comment éliminer le virus SARS-CoV-2 ?
Les virus présents sur une surface, comme une table, une poignée ou nos mains, conservent-ils la capacité d’infecter des cellules ? Pour limiter l’épidémie, cette question est un enjeu clé. Ainsi, des études comparent la stabilité du SARS-CoV-2 dans différents environnements. De premières données suggèrent qu’il faut attendre deux à quatre jours pour que tous les virus présents perdent totalement leur activité. Cela dépend des conditions de température, d’humidité et des matériaux. En conditions très contrôlées en laboratoire, on mesure le temps nécessaire pour que la moitié des virus se désagrègent, diminuant ainsi leur capacité à infecter un hôte. Cette durée est de trois heures environ sur du carton contre presque sept heures sur du plastique.
Ainsi, être en dehors d’un hôte rend le virus vulnérable. Et les virus possédant une enveloppe, comme c’est le cas du SARS-CoV-2, le sont encore plus. Cette enveloppe est constituée principalement de lipides et ressemble beaucoup à la membrane plasmique des cellules, et ce pour une raison simple : l’enveloppe du virus se forme à partir de la membrane cellulaire. En effet, le virus acquiert cette enveloppe en bourgeonnant à partir d’une cellule au moment d’en sortir et il la perd en fusionnant avec une autre cellule au moment d’y entrer. Si cette enveloppe lui est donc indispensable pour infecter une cellule et participe ainsi de sa virulence, elle est aussi sa faiblesse quand il est hors de l’hôte. Aussi fragile qu’une membrane cellulaire, l’enveloppe va souffrir de la température, de la sécheresse et… du savon. Anodin à nos yeux, le savon est une arme d’autant plus intéressante que les mains sont une voie de transmission importante des virus respiratoires.
En effet, le savon contient des molécules, appelées tensioactifs. Les études ont montré que les tensioactifs de type anionique, généralement présents dans nos savons en pain ou liquides, inactivent les virus. Deux mécanismes sont suggérés. Les tensioactifs peuvent s’attacher à la membrane des virus enveloppés et la désagréger. Ils peuvent également se lier aux protéines présentes à la surface du virus et lui faire ainsi perdre tout son pouvoir infectieux. Laver les mains n’agit donc pas seulement pour éloigner le virus mais également pour l’inactiver. Quant à l’alcool, son efficacité a été démontrée sur les virus de type coronavirus mais les mécanismes d’action en jeu ne sont pas précisément décrits. Son efficacité est cependant diminuée sur des mains salies par des matières grasses, alors que le savon reste efficace.

informations mises à jour le 14/01/2021


La perte d’odorat suite à une infection est un phénomène bien connu dans différentes pathologies communes, comme le rhume ou la grippe saisonnière. Un cas a également été décrit chez un patient atteint lors de l’épidémie de SRAS en 2003. La plupart du temps, cette perte est transitoire et la récupération se fait dans des délais très variables, de quelques jours à plusieurs années selon les patients.
L’odorat a plus d’importance qu’on ne le croit. En temps normal, nous percevons les odeurs quand des molécules odorantes entrent dans la cavité nasale et se lient aux cellules olfactives. Celles-ci tapissent le haut de cet espace, sur une surface grande comme un timbre-poste : l’épithélium olfactif. L’information parvient ensuite au bulbe olfactif par l’intermédiaire des fibres nerveuses puis est transmise au cerveau. Les molécules odorantes peuvent tout aussi bien provenir de la bouche que de l’air ambiant inhalé par les narines (voir figure). En effet, dans le milieu chaud et humide de la bouche, les aliments mastiqués émettent de nombreuses molécules odorantes qui parviennent à la cavité nasale en empruntant une sorte de passage secret à l’arrière de la bouche : la voie rétro-nasale. C’est pourquoi la perte d’odorat entraîne une diminution considérable des sensations que l’on a en mangeant.
Les virus, comme celui de la grippe et vraisemblablement le SARS-CoV-2, provoquent une réaction inflammatoire qui dégrade les cellules olfactives ainsi que les fibres nerveuses qui y sont connectées. L’odorat s’en retrouve diminué ou transitoirement supprimé. Différents laboratoires ont fait état de la capacité théorique du virus SARS-CoV-2 à pénétrer dans les cellules du cerveau, mais à ce jour il n’a pas été démontré que c’était effectivement le cas chez les patients.
Une étude européenne menée sur plusieurs centaines de patients montre que la perte de goût serait, comme la perte d’odorat, un des symptômes de la Covid-19. Dans ce cas c’est la perception des saveurs (salé, sucré, acide, amer) qui est altérée. Mais les mécanismes expliquant la perte ou les troubles du goût ne sont pas encore compris.
De nombreux témoignages, dans différents pays, font état d’une perte d’odorat, accompagnée ou non d’une altération du sens du goût, chez des patients atteints de Covid-19. La proportion des personnes touchées semble même assez élevée. C’est pourquoi on utilise ces symptômes pour aider au diagnostic de Covid-19.
L. Le SARS-CoV-2 fait-il perdre l’odorat ?
Olfaction directe et rétro-olfaction : deux trajets possibles pour les molécules odorantes.
©Niklas Hamann /Unsplash/Getty Images Plus
© J. Mihoubi/Universcience

informations mises à jour le 14/01/2021



K. Comment peut-on guérir sans traitement ?
Sans traitement, une majorité des malades de la Covid-19 parvient tout de même à guérir. Comment font-ils ? Quand nous tombons malades et que nous guérissons « naturellement », c’est-à-dire sans traitement spécifique, c’est parce que notre organisme possède un ensemble de mécanismes permettant de lutter contre l’infection : la réponse immunitaire. Elle se déroule en deux temps ; d’abord se déclenche l’immunité innée puis vient l’immunité adaptative. La première est immédiate, la seconde particulièrement efficace.
Dès qu’un microbe étranger pénètre dans l’organisme, les cellules de l’immunité innée, présentes comme des sentinelles, détectent l’intrus en repérant des éléments de son matériel génétique ou bien des molécules présentes à sa surface. Elles secrètent des substances chimiques qui alertent de nouvelles cellules de l’immunité afin qu’elles viennent en renfort, et attirent des cellules de l’inflammation qui vont aider leur passage et déclencher un processus d’ingestion et de digestion du microbe, processus qu’on appelle la phagocytose.
Si le microbe est déjà connu de l’organisme et qu’il est encore « en mémoire », l’immunité acquise se déclenche également très vite et agit de façon très efficace contre le microbe. Ce n’est malheureusement pas le cas à l’égard du SARS-CoV-2, qui est nouveau pour nous tous. L’immunité acquise est, dans ce cas, plus lente à s’amorcer. Des morceaux de microbe issus de la phagocytose permettent de déclencher une sélection des globules blancs les mieux adaptés pour lutter contre le microbe. Ils se multiplient et certains produisent en grande quantité des anticorps spécifiques contre le microbe, capables de le neutraliser. Certaines cellules intervenues dans ce processus persistent longtemps après l’élimination du microbe et permettent d’en garder la mémoire.
Pour la Covid-19, il a été démontré que les patients qui guérissent ont produit des anticorps dirigés contre le virus dans leur sang. La durée pendant laquelle notre corps peut continuer de les produire n’est cependant pas encore connue. C’est d’ailleurs l’un des enjeux de la vaccination actuelle : obtenir un vaccin qui procurera une immunité adaptative pour une durée la plus longue possible. Les chercheurs proposent également de développer une sérothérapie dirigée contre le SARS-CoV-2, consistant à récupérer des anticorps dans le sang de patients guéris pour les injecter chez les patients aux symptômes graves afin d’aider leur immunité à lutter efficacement contre le virus.
©selvanegra/iStock / Getty Images PlusPlus
informations mises à jour le 14/01/2021


J. Quels traitements contre le SARS-CoV-2 ?
À ce jour, il n’y a pas encore de traitement curatif contre le SARS-CoV-2. Le protocole médical de prise en charge des patients atteints vise à atténuer les symptômes en diminuant la fièvre ou en utilisant des appareils d’assistance respiratoire. Cette approche est très utile, car elle permet de soulager les symptômes du patient tout en donnant le temps à son système immunitaire de le guérir (voir question K).
Des anticoagulants ont été ajoutés à cet arsenal quand on a compris que le virus pouvait provoquer la coagulation du sang (voir question H). Mais le premier médicament ayant montré un bénéfice conséquent en termes de mortalité au cours d’un essai clinique d’ampleur est un corticoïde déjà utilisé dans des affections pulmonaires : la dexaméthasone. Cette molécule réduit la mortalité chez des patients atteints d’une forme sévère de la Covid-19 et nécessitant un apport en dioxygène. Un tiers des patients sous ventilation mécanique est concerné. En revanche, elle ne montre aucun bénéfice sur des patients souffrant d’une atteinte faible à modérée.
L’efficacité de la dexaméthasone tient notamment dans sa capacité à contrer l’inflammation exagérée caractéristique d’un certain nombre de cas graves de Covid-19 (voir question O). Comme les autres corticoïdes, elle agit en pénétrant dans les cellules et en modifiant leur activité : les cellules immunitaires produisent moins de facteurs favorisant l’inflammation et, pour certaines, plus de molécules anti-inflammatoires. Si l’on se rappelle que l’inflammation est une réaction défensive de l’organisme, on comprend alors qu’un usage trop précoce de la dexaméthasone pourrait empêcher le système immunitaire de s’opposer à la multiplication du virus. C’est une explication probable de son absence d’efficacité sur les patients non gravement atteints, voire de l’apparition d’effets favorisant la maladie. Donné trop tôt, il affaiblit nos défenses, donné plus tard, il limite l’inflammation démesurée et devient bénéfique. Voilà pourquoi il est fondamental de déterminer précisément la dose et le stade de la maladie où ce médicament doit être administré. Le traitement contre la Covid-19 s’apparente de plus en plus à une combinaison de molécules ciblant à la fois le virus et le système immunitaire selon un tempo qui doit être parfaitement déterminé.
©Francisco Àvia Hospital Clínic, Barcelone, Espagne
informations mises à jour le 14/01/2021

I. Comment une maladie peut-elle passer de l’animal à l’homme ?
Quand un micro-organisme, présent initialement dans la faune sauvage ou domestique, provoque une maladie infectieuse humaine, on appelle cela une zoonose. Pour qu’elle émerge, une première transmission d’animal à homme doit avoir lieu. Cela implique une rupture de la barrière d’espèce, c’est-à-dire que le micro-organisme en évoluant et à force de contacts répétés avec le nouvel hôte parvient à s’y développer. L’histoire est jalonnée d’exemples : la maladie à virus Ebola, le SIDA ou encore la grippe aviaire.
À l’origine, un micro-organisme est particulièrement adapté à une ou plusieurs espèces. C’est le cas de bon nombre de coronavirus dont on sait qu’ils sont établis et circulent chez les chauves-souris. Celles-ci ont la particularité d’héberger ces virus sans en être malades car elles sécrètent en permanence des interférons (voir question N). Elles constituent donc un très bon « réservoir ». Passer d’un réservoir primaire, comme la chauve-souris, à un nouvel hôte implique une combinaison d’évènements. Des sauts sporadiques peuvent avoir lieu : un virus passe accidentellement entre individus d’espèces différentes qui n’ont pas nécessairement de symptôme. Ces opportunités de transmission sont favorisées par des changements climatiques ou des modifications d’écosystèmes, comme la déforestation. Cela crée des contacts entre espèces qui ne se seraient pas produits sinon. De plus, les épidémies liées aux coronavirus mettent en évidence le rôle clé d’un autre animal faisant l’intermédiaire entre l’espèce réservoir et l’humain. Il s’agit souvent d’un animal dont la rencontre avec l’humain est plus fréquente, comme la civette lors de l’épidémie de SRAS en 2002 ou le dromadaire pour l’épidémie persistante de MERS.
Mais ces occasions de transmission ne suffisent pas à elles seules pour expliquer la rupture d’une barrière d’espèce. La compatibilité du virus avec le nouvel hôte est également déterminante dans sa capacité à l’infecter efficacement et à se transmettre ensuite d’individu à individu. Ces aptitudes peuvent s’acquérir de manière aléatoire à mesure que des changements, des mutations, dans le matériel génétique du virus apparaissent. Les coronavirus sont particulièrement prompts à muter. Couplés aux changements démographiques et aux mouvements de population, ces mécanismes participent du déclenchement ponctuel d’épidémies, voire de pandémies comme nous le voyons aujourd’hui avec la Covid-19.

©Roger Tidman/Photoshot/Biosphoto
informations mises à jour le 14/01/2021


H. Pourquoi le virus ne s’attaque qu’à certains organes ?
Pour qu’un virus soit pathogène pour l’humain, il doit posséder en surface des protéines capables de se lier à des récepteurs présents sur des cellules humaines. Chez les coronavirus, ces protéines sont les « spicules ». Elles forment une sorte de couronne autour du virus (d’où son nom, « corona » signifiant couronne en latin). Du côté des cellules, les récepteurs de ces spicules sont appelés ACE2. Toute cellule qui possède à sa surface des récepteurs ACE2 est donc susceptible d’être infectée. C’est le cas des cellules qui tapissent le nez et la gorge : ce sont les premières infectées, d’autant mieux qu’elles sont facilement accessibles (voir question E). De là, le virus gagne les cellules des alvéoles pulmonaires (voir question A) également pourvues du récepteur ACE2. Puis il peut provoquer la coagulation du sang en infectant les cellules constituant les parois des petits vaisseaux sanguins ayant des récepteurs ACE2. Et c’est également le cas des cellules du cœur, de l’intestin et du rein, que le virus peut donc aussi atteindre.
Les virus ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Pour se répliquer, ils ont besoin d’infecter les cellules d’un hôte. Pour cela, les virus ont à leur surface des protéines qui sont de véritables clés d’entrée. En effet, nos cellules possèdent une membrane qui joue le rôle d’une frontière, hautement contrôlée, entre l’intérieur et l’extérieur. Pour autant, les cellules ont naturellement besoin de faire entrer des éléments nécessaires pour elles (comme des acides aminés récupérés après la digestion d’un repas) ou de libérer dans le corps des éléments qu’elles produisent. Ces échanges sont finement régulés par des récepteurs présents à la surface de la cellule. Mais comme les besoins des organes sont différents, les récepteurs de leurs cellules ne sont pas les mêmes. Par exemple une cellule de foie n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes récepteurs qu’une cellule de poumon.
Image du SARS-CoV-2, isolé à partir d’un patient, obtenue par microscopie électronique montrant une cellule (en vert) infectée par le virus (en violet).
©NIAID
informations mises à jour le 14/01/2021


G-bis. Comment a-t-on pu gagner du temps pour trouver un vaccin contre la Covid-19 ?
Contre le SARS-CoV-2, les vaccins sont élaborés dans un temps record, qu’ils soient à ARN ou plus traditionnels. De nombreuses entreprises se sont lancées dans la course avec une seule certitude, acquise lors des recherches sur le virus SARS-CoV-1 : le vaccin doit cibler le spicule S. Pour gagner du temps, la plupart ont mis en œuvre la technique dans laquelle elles ont développé une expertise. Mais fabriquer un vaccin atténué, à vecteur ou sous-protéique prend du temps (voir question U). C’est là que le vaccin à ARN messager a fait la différence : cette molécule est facile à synthétiser.
Ensuite, quel que soit le type de vaccin, les étapes suivantes ont été raccourcies : au lieu de se succéder, les trois phases de recherche clinique se superposent. Pour ces tests, les cohortes à grande échelle sont rapidement constituées car les volontaires ne manquent pas. Si le vaccin s’avère prometteur, les industriels lancent sa production avant même les conclusions définitives des essais. Le risque financier est énorme. Mais il est couvert, en grande partie, par les précommandes considérables des États. Enfin, l’étude des dossiers a été une priorité des grandes agences du médicament. Beaucoup d’obstacles ont donc été levés mais plusieurs questions demeurent. Quelle sera l’efficacité du vaccin sur la population entière et combien de temps durera la protection qu’il procure ?
© gevende/E+ Getty Imagesages Plus
informations mises à jour le 14/01/2021


G. Pourquoi mettre au point un vaccin prend-il habituellement si longtemps ?
La mise au point d’un vaccin se fait en plusieurs étapes. En premier lieu il faut comprendre comment le microbe fonctionne : comment il infecte et ce qui le rend pathogène. Ensuite il faut choisir le type de vaccination. Par exemple, cherche-t-on à atténuer la virulence du microbe ? Utilisons-nous un vaccin existant en essayant de l’adapter (voir question F) ? Une fois un prototype prometteur obtenu, viennent les premières étapes de test en laboratoire. Le vaccin est testé en
« préclinique » sur des cellules en culture, donc in vitro, puis in vivo sur un petit animal et enfin sur les singes. Il faut vérifier à chaque étape que le vaccin provoque bien une production d’anticorps et de lymphocytes T protecteurs et qu’il n’entraîne pas d’effets secondaires.
Les tests sur populations humaines peuvent alors commencer, on parle ici de phase de recherche clinique. Pour ce faire, des cohortes de volontaires compatibles avec ces tests doivent être recrutées. Il s’agit, à ce stade, de démontrer que l’injection du vaccin ne provoque pas d’effets secondaires, de trouver le juste dosage, le bon rythme des injections successives et de vérifier que les personnes vaccinées produisent bien des anticorps contre le microbe. Une dernière validation à grande échelle du vaccin ne peut être faite que sur une grande cohorte de patients vaccinés. Toutes ces étapes prennent du temps, généralement deux à cinq ans, parfois dix ans ! Suite à sa commercialisation, le vaccin est dans son ultime phase, celui de son suivi au fil des années chez les patients.
© gevende/E+ Getty Imagesages Plus
informations mises à jour le 14/01/2021


F. Quelles pistes de vaccin suit-on contre la Covid-19 ?
Quand nous « tombons malades » et que nous « guérissons », c’est le résultat d’une rencontre entre un microbe et notre système immunitaire (voir question K). Les vaccins utilisent ce phénomène. Lorsque notre système immunitaire défend notre organisme, il a plusieurs cordes à son arc. L’une d’elles est de produire des anticorps neutralisants, qui vont spécifiquement bloquer l’action d’un microbe donné en se fixant sur lui. L’avantage de ce mécanisme de défense est qu’il peut rester « en mémoire » dans notre organisme : les cellules qui produisent les anticorps spécifiques à certains microbes peuvent rester plusieurs années (voire des décennies) dans notre corps, prêtes à répondre encore plus rapidement à la prochaine intrusion de ces mêmes microbes. Cette mémoire explique que nous n'attrapons qu'une seule fois certaines maladies infantiles, comme la rubéole ou les oreillons. Si le même virus attaque une deuxième fois il est immédiatement neutralisé. La vaccination repose sur ce principe de « défense » et de « mémoire ».
Vacciner consiste à simuler une première rencontre entre un microbe et nos cellules de l’immunité, mais sans provoquer la maladie. Si le microbe se présente ensuite, la réponse, notamment de nos anticorps, sera rapide, plus efficace et notre corps mieux protégé. Un des moyens pour créer un vaccin est d’identifier des composants microbiens capables de déclencher la mise en place d’une telle mémoire immunitaire. Pour la recherche d’un vaccin contre le SARS-CoV-2, on gagne du temps en exploitant les travaux réalisés sur le virus SARS-CoV-1, responsable de l’épidémie de 2003, car les spicules qui recouvrent ces deux virus sont très similaires. Aussi appelées protéines S, ils permettent au virus d’entrer dans les cellules cibles (voir question H). Or, des expériences menées in vitro et chez l’animal montrent que des anticorps spécifiques peuvent être produits et bloquer l’entrée du virus dans les cellules en se fixant sur les spicules du SARS-CoV-1. Cela ouvre une piste prioritaire pour la recherche vaccinale contre le SARS-CoV-2.
Parmi plus de 200 candidats vaccins, dont une soixantaine sont en phase clinique, différentes techniques sont utilisées. Il s’agit de mettre en contact ces spicules du SARS-CoV-2 avec l’organisme afin qu’il produise des anticorps dirigés contre eux. Pour ce faire, les approches classiques consistent à injecter ces protéines S. Mais la première technique à recevoir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché en Europe se base sur une autre stratégie : faire fabriquer temporairement la protéine S par nos propres cellules.
©Sergei Anischenko/iStock/Getty Images Plus
informations mises à jour le 14/01/2021


E. Comment limiter la transmission ?
Pour contenir ou ralentir la propagation du virus, il est essentiel de connaître ses voies de transmission. Le SARS-CoV-2 se transmet de personne à personne et essentiellement de deux façons : par contact et par voie aérienne. Le virus prolifère dans les tissus de l'arbre respiratoire et se retrouve ensuite dans les sécrétions respiratoires. Il sort de l’organisme sous forme de gouttes de liquide que l’on peut émettre en parlant, avec une portée d'environ 2 mètres, et plus loin encore quand on tousse ou que l’on éternue. Les gouttelettes contenant du virus sont projetées dans l’air puis retombent sur les surfaces. Un sujet sain à proximité peut les inhaler et être infecté. Des microgouttelettes, appelées aérosols, peuvent rester plus longtemps en suspension dans l’air avant de retomber, voire être entraînées par des courants d’aération. On ne sait pas combien de temps le virus reste infectieux dans de telles conditions, mais il est recommandé aux personnes saines de porter un masque pour se protéger des aérosols. La transmission émane de toute personne infectée par le virus, quand bien même elle n’a pas encore déclaré la maladie ou qu’elle reste asymptomatique. Le port du masque est donc également conseillé pour éviter de contaminer les autres en arrêtant physiquement une partie des gouttelettes émises.
Une fois retombées, les gouttelettes émises par une personne déjà infectée se retrouvent sur la peau, les mains et les objets qu’elle a touchés. Il a été démontré en conditions contrôlées au laboratoire que les virus peuvent demeurer actifs hors d’un sujet porteur de quelques heures à quelques jours. Pour le SARS-CoV-2, cette durée semble dépendre de la nature de la surface et augmenter avec l’humidité (voir question M). En touchant les surfaces souillées, un sujet sain se retrouve exposé. Le virus ne rentre pas par la peau mais par le contact des mains sur le nez ou la bouche si elles n’ont pas été lavées. Les scientifiques examinent également la possibilité d’une voie d’entrée par le frottement des mains sur les yeux.
Pour certaines pathologies virales, dont la Covid-19, il existe des personnes infectées qui transmettent le virus à un grand nombre de sujets sains. On parle alors d’événements de « super-propagation ». Cela peut notamment se produire si ces personnes sont entrées en contact avec un grand nombre de sujets, par exemple lors d’un rassemblement, ou si elles possèdent une concentration de virus (charge virale) exceptionnellement élevée. En Corée du Sud, les autorités sanitaires ont examiné l’emploi du temps des premiers cas avérés de Covid-19 et rapportent qu’un de ces cas, avant d’avoir été dépisté positif, a participé à deux rassemblements au sein desquels plus de 1000 personnes ont ensuite été testées positives.
©rclassenlayouts/iStock/Getty Images Plus
informations mises à jour le 14/01/2021


Non, la maladie Covid-19 est différente de la grippe. Et la comparaison est encore plus trompeuse si l’on confond les grippes, dites pandémiques, très rare, et la grippe saisonnière qui circule d’un hémisphère de la planète à l’autre et y séjourne tous les ans tant que les conditions y sont hivernales. Cette dernière est, en général, sans conséquence grave, mais occasionne, notamment chez les personnes âgées, une surmortalité qu’on estime tout de même entre 290 000 et 650 000 décès chaque année dans le monde. Les traitements antiviraux et la vaccination empêchent que le bilan ne soit plus lourd.
De son côté, la grippe pandémique est causée à chaque fois qu’un nouveau sous-type de virus apparaît. La « grippe espagnole » de 1918-1919 était causée par un virus H1N1, la grippe asiatique de 1957-1958, par un virus H2N2, et en 2009 un nouveau virus H1N1 s’est propagé. À l’origine de ces épidémies, il y a un transfert d’une espèce animale à l’humain (passage de la barrière d’espèce), puis le virus se propage par contamination interhumaine. Le nouveau virus peut alors infecter une population humaine plus élargie car elle est dépourvue d’anticorps contre lui.
La grippe pandémique est donc un bon modèle pour les épidémiologistes qui cherchent à prédire l’évolution de la maladie Covid-19, mais ils doivent prendre en compte les différences biologiques qui existent entre les deux types de virus. En effet ils appartiennent à des familles distinctes, ne se fixent pas sur les mêmes récepteurs cellulaires de l’hôte et agissent donc différemment. C’est pourquoi il faut rechercher d’autres traitements antiviraux contre la Covid-19.
D. La maladie Covid-19, c’est une grosse grippe ?
©RapidEye/E+ Getty Images
informations mises à jour le 14/01/2021


Cette question est cruciale pour savoir s’il existe, ou pas, une forme d’immunité contre ce virus dans l’espèce humaine. Si ce n’est pas le cas on parle de virus émergent, soit parce qu’il provient d’un ancien virus qui aurait suffisamment changé par mutation, soit parce qu’il était jusqu’alors inconnu chez l’humain. Le SARS-CoV-2 relèverait du deuxième cas. La plupart des virus émergents (HIV, Ebola, SARS-CoV, MERS-CoV) viennent de réservoirs animaux, c'est à dire d'animaux qui hébergent ces virus sans en être malades.
C. Le SARS-CoV-2 et l’humain viennent-ils de se rencontrer ?
Même s’il existe d’autres coronavirus, celui-ci possède des différences génétiques suffisamment grandes pour être considéré comme nouveau. Par ailleurs, le matériel génétique des coronavirus est connu pour accumuler des changements par mutations au cours du temps. Or, les scientifiques ont démontré que les échantillons du virus SARS-CoV-2 provenant de différents patients étaient génétiquement très proches : le virus n’a donc pas encore eu le temps d’accumuler beaucoup de mutations depuis qu’il est capable d’infecter notre espèce. Ainsi, il est très probable que ce virus n’ait qu’une seule origine animale et n’ait infecté que depuis très récemment l’humain, qui n’avait donc pas d’immunité préexistante.
Image reproduisant la morphologie d’un coronavirus, où l’on distingue les spicules répartis tout autour de sa surface
©Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
informations mises à jour le 14/01/2021

B-bis. Tests Covid-19 : pourquoi existe-t-il différentes voies de prélèvement ?
Pour déterminer si une personne est porteuse du SARS-CoV-2, on prélève des sécrétions provenant des voies respiratoires, car c’est là que le virus se loge et se multiplie. Mais il n’est pas présent partout de façon équivalente. On le trouve en abondance dans le pharynx (voir figure).
La fiabilité du test est donc la meilleure quand le prélèvement est effectué en introduisant un écouvillon (grand coton-tige) par la narine, le long du plancher nasal jusqu’à la muqueuse du nasopharynx. L’écouvillon est ensuite placé dans un tube contenant un milieu liquide de conservation et sa tige est cassée de façon à fermer le tube. L’acte de prélèvement est désagréable sans être réellement douloureux, mais il peut être difficile à réaliser ou très mal vécu chez certains patients (enfants, personnes présentant des troubles psychiatriques, personnes très âgées). Dans ce cas il est possible d’atteindre le pharynx par la gorge (voie oropharyngée), ce qui est moins désagréable mais peut provoquer un réflexe nauséeux.
On peut également réaliser un prélèvement de salive, par simple crachat du patient ou à l’aide d’une pipette introduite dans la bouche, ce qui est beaucoup plus simple et moins désagréable. Cependant la concentration de virus est beaucoup plus faible dans la bouche que dans le pharynx. Ce mode de prélèvement est donc réservé aux personnes qui présentent des symptômes depuis moins de 7 jours, car c’est dans cette phase de la maladie que la quantité de virus est la plus élevée. De plus, un résultat négatif ne garantit pas une absence de virus, ce mode de prélèvement étant moins sensible que les autres. Les tests salivaires doivent être ensuite analysés par la méthode RT-PCR (voir question B), la plus efficace.


© Ketpixel/iStock/Getty Images Plus
informations mises à jour le 14/01/2021

B. PCR, test antigénique, quelles différences ?
Depuis l’identification du génome du SARS-CoV-2, en un temps record, dès le mois de janvier 2020, plusieurs tests ont été mis au point. Pour détecter la présence du virus dans un prélèvement, deux méthodes sont mises en œuvre : la RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase associée à une transcription inverse) et le test antigénique.
La première permet de détecter des quantités extrêmement faibles de virus mais nécessite d’acheminer le prélèvement depuis le laboratoire vers un plateau technique. Après y avoir inactivé le virus en le chauffant, son matériel génétique, l’ARN, est extrait puis mis au contact d’enzymes qui en font un très grand nombre de copies. C’est pourquoi de très faibles quantités du matériel génétique du virus peuvent être ainsi détectées. Pendant cette phase de réplication, si le virus était présent dans le prélèvement, on observe la fluorescence émise par l’échantillon qui augmente régulièrement avec le nombre de copies. Cette méthode est coûteuse en temps, en matériel et en personnel.
Plus rapide (de 10 à 30 minutes) mais moins sensible, le test antigénique révèle la présence de la protéine S, située sur l’enveloppe du virus, ou de la protéine N, située à l’intérieur. Ces protéines sont également appelées «antigènes». Le prélèvement est mélangé à des anticorps qui ne se combinent qu’avec la protéine ciblée, si elle est présente, et provoquent alors l’apparition d’une bande colorée. Mais la présence du virus n’est révélée ainsi que s’il est présent en grande quantité dans le prélèvement. C’est pourquoi la Haute Autorité de santé recommande de réaliser ces tests le plus tôt possible dans un délai maximum de 7 jours après un contact ou après l'apparition de symptômes. Au-delà, la quantité de virus présente chez les patients risque d’être trop faible. Le prélèvement est à réaliser dans le nasopharynx car il contient plus de virus que la bouche ou la gorge (voir question B-bis).
La période où l’on est le plus contagieux s’étend de 48 heures avant le début des symptômes jusqu’à 7 jours après. La rapidité des tests antigéniques est donc un atout majeur pour limiter la transmission. En outre, ils permettent de repérer les sujets qui ont une concentration élevée de virus et sont donc potentiellement les plus contagieux.


©D. Calma/IAEA
©Moritz Thibaud/ABC/Andia.fr
Test RT-PCR : les courbes bleues montrent l’augmentation de fluorescence de tests positifs, la courbe rouge correspond à un prélèvement négatif.
Test antigénique : une bande colorée apparaît à côté de la bande de contrôle si le test est positif.
informations mises à jour le 14/01/2021


La maladie Covid-19 se manifeste par une pneumonie particulière. Une pneumonie est une infection des poumons qui apparaît brutalement. Les alvéoles des poumons se remplissent alors de pus et de liquide au lieu de se gorger d’air pour fournir le dioxygène au sang (voir figure). Cela provoque de la fièvre et une toux importante, rend la respiration difficile et douloureuse et limite notamment l’apport d’oxygène à l’organisme.
A. Quel rapport entre la Covid-19 et la pneumonie ?
Généralement les pneumonies sont causées par la prolifération d’une bactérie, comme le pneumocoque, ou d’un virus, comme celui de la grippe influenza ou le récent SARS-CoV-2 provoquant la maladie Covid-19. Dans le cas des bactéries, les alvéoles touchées sont généralement très localisées dans une partie du poumon, tandis qu’une pneumonie virale est, en général, plus étendue : ces différences seront donc visibles en réalisant un scanner des poumons. Mais pour identifier formellement le virus il faut réaliser un prélèvement. (voir question Bbis)


© klebercordeiro/iStock/Getty Images Plus
© J. Mihoubi/Universcience
informations mises à jour le 14/01/2021


#LaScienceEstLà

Microscopie électronique du virus SARS-Cov-2 isolé sur un patient américain
© NIAID-RML
Transmission, traitement, vaccin, recherches en cours... En 23 questions-réponses, l’exposition « Coronavirus : ce que sait la science ! » propose une revue du savoir, simple et accessible, sur l’épidémie de Covid-19.
Les sciences nous aident à comprendre le monde et la culture scientifique doit aller à la rencontre de tous. En cette période de crise sanitaire, le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie repensent leurs offres et vous proposent cette exposition virtuelle gratuitement, en ligne et en téléchargement. Pour une viralité du savoir avant tout ! #LaScienceEstLà #CultureChezNous
Centre de science, collectivité, centre d’accueil… : vous pouvez télécharger librement cette exposition en version imprimable au format .pdf (23,5 Mo), afin de la mettre à disposition de vos publics et du plus grand nombre.
Si vous souhaitez la version de cette exposition en « haute définition », proposer une adaptation ou une traduction en langue étrangère, nous sommes à votre écoute et serons heureux d’en faire profiter le plus grand nombre.
Votre contact : DITI@universcience.fr
Coronavirus : ce que sait la science !




Exposition réalisée par les services d'Universcience, librement téléchargeable et imprimable.
© Universcience mars 2020
U. Vaccin atténué, inactivé, sous-unitaire, à vecteur ou à ARN, quelles différences ?
©Photo by Justin Tallis/POOL/AFP
Vacciner consiste à mettre en contact le corps avec un morceau du pathogène de façon que le système immunitaire garde une mémoire de cette rencontre et agisse rapidement et efficacement contre le microbe entier lors d’une rencontre ultérieure (voir questions F et P). Mais quel morceau choisir ? Grâce au séquençage rapide du génome du SARS-CoV-2 et aux études sur d’autres coronavirus, on a pu identifier la cible idéale. Il s’agit de la molécule de surface S, celle qui donne au virus cet aspect hérissé de piquants. L’étape suivante consiste à présenter correctement à l’organisme cette protéine S qui ne peut, à elle seule, déclencher la maladie. Pour ce faire, différentes techniques existent, chacune avec ses atouts et ses limites. En voici quelques-unes.
C’est l’un des plus anciens procédés. Il consiste à inoculer le microbe entier privé de son caractère pathogène. Il contient évidemment la protéine S et stimule donc le système immunitaire. Ces vaccins vivants atténués sont déconseillés aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Celles-ci sont en effet moins aptes à lutter contre des microbes qui bien qu’atténués se multiplient encore.
C’est le principe du vaccin combiné contre les trois infections rougeole, oreillons et rubéole (ROR).
Société mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Codagenix, associée au Serum Institute of India.
Il s’agit d’injecter uniquement l’antigène cible. On inocule donc la protéine S ou une partie de cette protéine, synthétisée en laboratoire. C’est la technique la plus utilisée dans les différents essais de vaccin contre la Covid-19. Elle est réputée d’autant plus sûre qu’elle ne comporte pas le virus entier. Mais elle nécessite l’ajout d’adjuvants dans le vaccin pour que le système immunitaire réagisse.
C’est le principe des vaccins contre la coqueluche, la méningite à méningocoque et l’hépatite B.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Novavax d’une part et Sanofi Pasteur associé à GlaxoSmithKline (GSK) d’autre part.
Le principe est ici de faire produire des protéines S par nos propres cellules. Pour ce faire, le vaccin contient une molécule appelée ARN messager (ARNm), enfermée dans une petite vésicule constituée de lipides. Après injection, celle-ci fusionne avec la membrane des cellules et y libère l’ARNm. Une machinerie présente naturellement dans les cellules suit alors les instructions contenues dans l’ARNm et produit des protéines S, mais de manière transitoire, car l’ARNm est une molécule qui se dégrade rapidement. Outre la rapidité et une certaine simplicité de fabrication, ce type de vaccin ne nécessite pas l’ajout d’adjuvant car la molécule d’ARNm joue elle-même ce rôle permettant la mise en place d’une réponse immunitaire forte et spécifique.
Aucun vaccin de ce genre n’était utilisé auparavant.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Pfizer et BioNTech d’une part et Moderna d’autre part.
Au lieu d’introduire directement la protéine S, cette méthode consiste à modifier un virus inoffensif pour l’homme de façon que sa surface comporte des protéines S. Ce virus joue le rôle d’un transporteur, on parle de vecteur viral. En transportant la protéine S dans l’organisme, il déclenche contre elle une réponse immunitaire.
C’est le principe du vaccin contre Ebola.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : AstraZeneca d’une part et CanSino Biologics associé à Beijing Institute of Biotechnology d’autre part.
Cette fois, l’agent infectieux est incapable d’engendrer des symptômes et de se multiplier. Bien toléré chez des personnes immunodéprimées, cette vaccination mime moins bien l’infection. L’immunité est moins performante. Voilà pourquoi plusieurs injections – ou rappels – sont nécessaires. L’ajout d’un adjuvant dans la composition vaccinale permet de compenser la moindre activation de nos défenses.
C’est le principe du vaccin contre la poliomyélite.
Sociétés mettant au point un vaccin de ce type contre la Covid-19 : Sinovac Biotech d’une part et Beijing Biological Products Institute d’autre part.
Vaccin vivant atténué
Vaccin sous-unitaire
Vaccin à ARN
Vaccin à vecteur
Vaccin inactivé
Infirmière et patient s’apprêtant à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 en décembre au Pays de Galles.

T. Pourquoi le sida et le paludisme n’ont-ils pas leurs vaccins ?
Moins d’un an après l’apparition de la maladie, plusieurs vaccins contre le SARS-CoV-2 existent. Le sida, dont le virus a été découvert en 1983, n’en a toujours pas. Le paludisme non plus. L’explication tient dans les particularités des agents infectieux responsables de ces maladies.
La mise au point d’un vaccin rencontre moins d’obstacles si le microbe varie très peu et stimule efficacement le système immunitaire. Le SARS-CoV-2 est de ceux-là, contrairement au parasite responsable du paludisme et au virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Le système immunitaire ne reconnaît pas un microbe dans son ensemble mais des petites parties, caractéristiques et immuables. En ciblant ces parties, il détruit le microbe. Malheureusement ces parties changent dans le virus du sida. Les erreurs se multiplient au moment de sa réplication et produisent des virus différents. Cette extrême variabilité est le principal obstacle à un vaccin qui cible un microbe précis, c’est-à-dire très peu variable. L’espoir viendra peut-être des recherches qui se focalisent sur les parties les plus stables du virus, bien que celles-ci induisent une faible réponse immunitaire.
Quant au paludisme, il est dû à un parasite qui est transmis à l’homme à l’occasion d’une piqûre de moustique. Injecté dans le sang, ce parasite infecte les cellules du foie. Après quelques jours, il infecte des globules rouges puis se retrouve dans le sang. Il peut ainsi passer à un nouveau moustique à l’occasion d’une autre piqûre. À chaque étape il se multiplie et adopte des formes très différentes. En particulier, les protéines présentes à sa surface varient beaucoup d’une phase à l’autre. Or ce sont justement ces protéines que le système immunitaire, et donc un éventuel vaccin, visent. Comme pour le sida, cette polymorphie est un écueil majeur à l’élaboration d’un vaccin.
En outre, pour le paludisme comme pour le sida, le vaccin ne devra pas mimer la réponse immunitaire mais l’améliorer. Car, pour ces deux maladies, les réactions immunitaires existent mais ne parviennent pas à éliminer les microbes.
© Victoria Jones / POOL / AFP
Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Grande–Bretagne, décembre 2020

S. Mais où est passé le pangolin ?
L’origine du SARS-CoV-2 demeure mystérieuse. On a soupçonné le pangolin d’avoir joué le rôle d’intermédiaire permettant au virus d’infecter l’humain. Est-il toujours le principal suspect ?
96 % : c’est le taux de ressemblance entre le génome du SARS-CoV-2 et celui d’un autre coronavirus présent chez une espèce de chauve-souris vivant en Chine. Voilà qui accrédite l’hypothèse d’une émergence (voir question I), en l’occurrence le passage du virus de la chauve-souris à l’espèce humaine.
Cependant, ce virus de chauve-souris ne peut infecter directement les cellules humaines : sa protéine de surface (S) est trop différente de celle qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules.
C’est là qu’intervient le pangolin. Car on a trouvé, chez certains spécimens, un coronavirus qui possède un gène capable de produire des protéines S très similaires à celles du SARS-CoV-2.
À partir de cette similarité, des chercheurs ont alors imaginé le scénario suivant : un pangolin porteur de ce coronavirus se retrouve également infecté par le coronavirus de la chauve-souris. Les deux virus se recombinent, prouesse courante dans cette famille de virus. Résultat : après être passé par cet animal, le nouveau virus recombiné possède le gène qui code la bonne protéine S.
Mais les ressemblances se sont révélées trompeuses.
La portion génétique du coronavirus trouvé chez le pangolin est trop différente de celle qui permet de produire la protéine du SARS-CoV-2.
Et c’est en fait un virus identique à 99 % (et non 96 %) qui pourrait accéder au titre de plus proche ancêtre du SARS-CoV-2. Les analyses de biogénétique ont montré que le virus responsable de la Covid-19 ne descend pas en droite ligne des coronavirus déjà trouvés chez la chauve-souris. Ils sont cousins, puisqu’il faut remonter au moins quarante ans en arrière pour trouver leur ancêtre commun. Et même cousins éloignés ! Le virus dont découle le SARS-CoV-2, juste avant qu’il n’infecte l’espèce humaine, est donc encore à découvrir. Et l’hôte qui l’héberge peut être un pangolin ou un tout autre mammifère.
© Roland Seitre / Minden Pictures / Biosphoto

Femelle pangolin et son petit, appartenant à l’espèce un temps suspectée : le Pangolin de Malaisie (Manis janavica)
R. Comment chercher un antiviral contre le
SARS-CoV-2 ?
Concevoir un nouveau médicament est un processus très long. Face à l’urgence sanitaire liée à la Covid-19, les chercheurs du monde entier se sont tournés vers des médicaments antiviraux déjà utilisés contre d’autres pathologies. On parle de repositionnement. Mais pour l’heure, les résultats sont décevants.
Seul un antiviral utilisé contre le VIH réduit de quelques jours le temps passé à l’hôpital par les patients atteints de la Covid-19 : le remdesivir. En revanche, il ne démontre pas d’effet sur la mortalité. Ce médicament agit sur une protéine virale dont le rôle est de copier le matériel génétique du virus, nucléotide après nucléotide. Le remdesivir est un analogue de l’un de ces nucléotides, qui, une fois incorporé dans la chaîne fraîchement constituée, la bloque. La réplication du virus devrait être ainsi empêchée… mais dans le cas du SARS-CoV-2, elle est seulement réduite. Cette efficacité décevante est sans doute due à une particularité des coronavirus: ils possèdent une protéine capable de détecter et retirer les erreurs introduites dans la copie en cours de production.
Puisque les médicaments déjà connus manquent d’efficacité contre la Covid-19, il faut en concevoir de nouveaux. La méthode consiste à bien connaître les cibles susceptibles de bloquer le développement du virus (voir question Q). C’est ainsi que les chercheurs ont déterminé la structure tridimensionnelle de plusieurs protéines virales, soit la façon dont les atomes sont liés les uns aux autres dans l’espace et forment ces énormes molécules. Ils modélisent ensuite in silico, c’est-à-dire informatiquement, la fixation entre des molécules candidates et une de ces protéines virales pour choisir celles qui pourraient inhiber le mieux son activité. Ce préliminaire numérique pourrait permettre de gagner du temps dans la sélection de molécules à synthétiser et à tester ensuite in vitro et in vivo.

Analyse Nicola De Maio, image logiciel ICM (Molsoft). Source DOI : 10.5281/zenodo.4041302
Représentation en 3D d’une protéine du SARS-CoV-2 (en gris) et du blocage de son activité par la fixation de l’antiviral remdesivir.
Q. Pourquoi les traitements contre les virus sont-ils très différents de ceux contre les bactéries ?
Les bactéries sont des organismes vivants, généralement constitués d’une seule cellule. Elles possèdent les éléments nécessaires pour se nourrir, respirer et engendrer une descendance dès lors qu’elles se trouvent dans un milieu adapté. Les traitements médicaux contre les bactéries consistent donc à les empêcher de se multiplier ou à les tuer en ciblant ces éléments. C’est l’action des antibiotiques. Pour les virus, cette méthode ne fonctionne pas. En effet, les virus ne peuvent se reproduire que s’ils parviennent à pénétrer dans une cellule du corps dont ils vont monopoliser les ressources pour se répliquer. Il ne s’agit donc plus de tuer une cellule autonome mais, au contraire, de préserver une cellule hôte tout en bloquant le cycle du virus qui la parasite. Et ce n’est pas chose aisée. C’est pourquoi les traitements se limitent le plus souvent à soulager les symptômes en attendant que le virus soit éliminé par le système immunitaire. Le VIH et le virus de l’hépatite C, qui provoquent des maladies chroniques, font pourtant exception : des traitements dits « antiviraux » particulièrement efficaces ont été mis au point. Il s’agit de bloquer l’une des étapes du cycle de ces virus, dont le point commun est d’avoir un génome à ARN, molécule légèrement différente de l’ADN.
Pour les coronavirus, le cycle de reproduction débute avec la phase d’attachement. Les spicules, situés à la surface des virus, se fixent à certains récepteurs des cellules pulmonaires (voir question H). Cela déclenche l’entrée du virus (endocytose) et aboutit, notamment, à la libération de son matériel génétique à l’intérieur de la cellule. Il va alors tirer avantage des ressources à disposition dans cette dernière. On parle de détournement. Au lieu de fabriquer des éléments pour la cellule, les acteurs de celle-ci se mettent à produire deux types de protéines virales (traduction) à partir du génome ARN de l’intrus. Ces protéines sont capables de se scinder pour former de plus petites protéines ayant différents rôles (clivage). Certaines s’associent et entreprennent notamment de copier le génome viral en de multiples exemplaires. C’est la réplication. Petit à petit, tous les constituants sont produits et s’assemblent pour former de nouveaux virus qui sortent de la cellule, soit discrètement (exocytose), soit en la détruisant.
C’est pourquoi, afin de s’attaquer aux protéines virales tout en préservant la cellule hôte, la recherche d’antiviraux contre les coronavirus suit trois pistes : empêcher la phase d’attachement en ciblant le spicule, bloquer le clivage des protéines ou bloquer leur réplication.

©Cordelia Molloy/Science Photo Library/Jounaid Mihoubi-Universcience
Cycle de reproduction du virus SARS-CoV-2 dans une cellule
P. Sans anticorps, notre corps peut-il se défendre ?
Les anticorps sont, à n’en pas douter, un mode d’action clé de notre système immunitaire pour faire face aux multiples intrusions microbiennes. Pour autant, ces protéines ne sont pas nos seules forces de défense. Parmi les autres dispositifs à l’œuvre, la réponse dite cytotoxique est particulièrement importante pour lutter contre des virus et peut constituer un type de mémoire immunitaire efficace pour protéger l’organisme à plus long terme, même lorsqu’il y a très peu d’anticorps.
L’étymologie du mot le laisse entendre (« cyto » signifie cellule), la réponse cytotoxique est nocive pour certaines cellules, notamment celles qui sont infectées. Elle fait intervenir un type de globules blancs, appartenant à la famille des lymphocytes T, capables de reconnaître des cellules atypiques, comme les cellules infectées, et de provoquer leur destruction. C’est au cours d’un contact rapproché, parfois appelé « baiser de la mort », que ces lymphocytes déversent sur leur cible des granules remplies de molécules toxiques. Ce sont, par exemple, les perforines, qui percent la membrane de la cellule infectée, entraînant sa destruction par un processus de dissolution chimique appelé lyse. D’autres molécules déclenchent un programme d’autodestruction de la cellule appelé apoptose. Ce mode d’action intervient en particulier lorsqu’un virus a déjà envahi une cellule pour s’y multiplier et qu’il se trouve alors insensible à l’action des anticorps.
Notre système immunitaire déploie donc une combinaison de dispositifs complémentaires, adaptée à la nature de chaque agent pathogène, leur nombre et leur virulence. Comme pour la production d’anticorps, la réponse cytotoxique nécessite quelques jours avant d’être opérationnelle la première fois. Elle peut constituer ensuite un groupe de cellules prêtes à agir plus vite et plus efficacement en cas de réinfection par le même agent pathogène, et ce même lorsqu’il y a très peu d’anticorps. La mise en place d’une telle mémoire immunitaire est l’un des objectifs recherchés lorsque l’on met au point un vaccin contre un virus. Moins évident à détecter expérimentalement que la présence d’anticorps, le développement d’une bonne réponse cytotoxique est un enjeu manifeste face au virus SARS-CoV-2 sur lequel travaillent nombre de chercheurs.

Un lymphocyte T tueur (en bleu) s'apprête à détruire sa cellule cible (en haut, en vert) grâce à des granules toxiques (rouges).
©NICHD/ J. Lippincott-Schwartz
O. Pourquoi certains cas de Covid-19 sont-ils graves ?
Chez certains patients, la Covid-19 présente des formes particulièrement sévères. On assiste, chez eux, à un affolement de la réponse immunitaire, cette réaction pourtant chargée de lutter contre les infections.
Lors d’une infection, des globules blancs aptes à détruire les virus et les cellules infectées migrent vers la zone malade. Cet afflux est régulé grâce à des protéines appelées cytokines. Avec le SARS-CoV-2 on constate une surproduction de cytokines. On parle d’« orage cytokinique ». La réponse immunitaire s’emballe. Elle détruit alors davantage les cellules qu’elle ne les défend.
La survenue de cet événement serait favorisée par un système immunitaire moins réactif aux nouvelles infections, comme celui des sujets âgés. Les pathologies chroniques comme l’obésité, certaines atteintes cardiovasculaires ou respiratoires, l’insuffisance rénale, le diabète favorisent aussi cette séquence d’événements. Ces maladies se caractérisent par l’arrivée constante de globules blancs et l’activation continuelle de cytokine dans les organes malades. Ces particularités expliqueraient la grande facilité du système immunitaire à s’emballer.
Cependant, des individus relativement jeunes, dont quelques enfants, ont présenté des formes graves de la maladie en l’absence de ces facteurs. Voilà ce qui pousse les chercheurs à identifier les autres paramètres aggravants.
À ce titre, le consortium international Covid Human Genetic Effort (Covid HGE) analyse l’ADN complet de patients. Ces travaux ont révélé, chez 3 % des patients gravement atteints, une défaillance particulière d’origine génétique : l’impossibilité complète de produire l’interféron (voir question N).
Une faible production d’interféron est couramment observée dans la Covid-19. Pour certains chercheurs, la maladie est d’autant plus grave que l’interféron fait défaut.
Le consortium a d’ailleurs découvert que 10 % des patients gravement atteints (très majoritairement des hommes âgés) synthétisent des anticorps dirigés contre leurs interférons, neutralisant ainsi malheureusement leur action. Ce problème pourrait être résolu en leur administrant un autre type d’interféron.

N. Comment peut-on être porteur du virus et ne pas avoir de symptômes ?
Molécule d’interféron humain. Cette protéine joue un rôle important dans la réponse immunitaire initiée contre le virus.
Très tôt, on a soupçonné que l’épidémie de Covid-19 était plus étendue que ce que montrait la détection des signes cliniques confirmés par un dépistage du SARS-CoV-2. Il existe effectivement une part silencieuse de l’épidémie : les infections asymptomatiques (pas de symptômes) et paucisymptomatiques (peu de symptômes). Cela semble être le cas pour la plupart des enfants.
L’une des raisons de cet état de fait est qu’il se joue, au sein de chaque hôte, une véritable course de vitesse entre le virus et la réponse immunitaire. Le résultat de cette course influence fortement l’issue de l’infection et l’intensité des symptômes associés. Dès les premières heures, lorsque le virus est entré dans les cellules de l’arbre respiratoire et a commencé de s’y répliquer, une réponse antivirale est enclenchée. Une cellule infectée est, par exemple, capable de détecter seule la présence d’un génome viral dans son cytoplasme. Elle se met alors à produire diverses molécules comme les interférons de type 1, dont un des rôles est de bloquer en partie le mécanisme de traduction à l’œuvre dans la cellule, la mettant ainsi presque à l’arrêt. La cellule limite alors sa propre capacité à fabriquer des protéines indispensables à son bon fonctionnement, mais empêche surtout la réplication du virus, qui dépend aussi de ce processus. La cellule n’est plus au service du virus et, en sécrétant l’interféron, transmet même le message d’alerte aux cellules avoisinantes, qui reproduisent à leur tour ce mécanisme de blocage. Si la réponse est suffisamment vigoureuse, et l’on pense que c’est par exemple le cas chez les enfants, la réplication virale peut être arrêtée avant l’apparition d’effet massif dû au virus. Pendant quelques heures à quelques jours, une personne peut ainsi être infectée mais ne présenter aucun ou peu de symptômes. Indépendamment de la gravité des symptômes, s’il y en a, les personnes infectées sont potentiellement contagieuses.
Malheureusement, et c’est probablement le cas du SARS-CoV-2, les coronavirus possèdent des armes qui ralentissent fortement la réponse antivirale et, notamment, l’action bénéfique de l’interféron au stade précoce de l’infection. Une des voies de recherche consiste aujourd’hui à comprendre comment le virus réduit l’action de l’interféron afin d’y remédier.
©theasis/E+/Getty Images
M. Hors de son hôte, comment éliminer le virus SARS-CoV-2 ?
Les virus présents sur une surface, comme une table, une poignée ou nos mains, conservent-ils la capacité d’infecter des cellules ? Pour limiter l’épidémie, cette question est un enjeu clé. Ainsi, des études comparent la stabilité du SARS-CoV-2 dans différents environnements. De premières données suggèrent qu’il faut attendre deux à quatre jours pour que tous les virus présents perdent totalement leur activité. Cela dépend des conditions de température, d’humidité et des matériaux. En conditions très contrôlées en laboratoire, on mesure le temps nécessaire pour que la moitié des virus se désagrègent, diminuant ainsi leur capacité à infecter un hôte. Cette durée est de trois heures environ sur du carton contre presque sept heures sur du plastique.
Ainsi, être en dehors d’un hôte rend le virus vulnérable. Et les virus possédant une enveloppe, comme c’est le cas du SARS-CoV-2, le sont encore plus. Cette enveloppe est constituée principalement de lipides et ressemble beaucoup à la membrane plasmique des cellules, et ce pour une raison simple : l’enveloppe du virus se forme à partir de la membrane cellulaire. En effet, le virus acquiert cette enveloppe en bourgeonnant à partir d’une cellule au moment d’en sortir et il la perd en fusionnant avec une autre cellule au moment d’y entrer. Si cette enveloppe lui est donc indispensable pour infecter une cellule et participe ainsi de sa virulence, elle est aussi sa faiblesse quand il est hors de l’hôte. Aussi fragile qu’une membrane cellulaire, l’enveloppe va souffrir de la température, de la sécheresse et… du savon. Anodin à nos yeux, le savon est une arme d’autant plus intéressante que les mains sont une voie de transmission importante des virus respiratoires.
En effet, le savon contient des molécules, appelées tensioactifs. Les études ont montré que les tensioactifs de type anionique, généralement présents dans nos savons en pain ou liquides, inactivent les virus. Deux mécanismes sont suggérés. Les tensioactifs peuvent s’attacher à la membrane des virus enveloppés et la désagréger. Ils peuvent également se lier aux protéines présentes à la surface du virus et lui faire ainsi perdre tout son pouvoir infectieux. Laver les mains n’agit donc pas seulement pour éloigner le virus mais également pour l’inactiver. Quant à l’alcool, son efficacité a été démontrée sur les virus de type coronavirus mais les mécanismes d’action en jeu ne sont pas précisément décrits. Son efficacité est cependant diminuée sur des mains salies par des matières grasses, alors que le savon reste efficace.

L’odorat a plus d’importance qu’on ne le croit. En temps normal, nous percevons les odeurs quand des molécules odorantes entrent dans la cavité nasale et se lient aux cellules olfactives. Celles-ci tapissent le haut de cet espace, sur une surface grande comme un timbre-poste : l’épithélium olfactif. L’information parvient ensuite au bulbe olfactif par l’intermédiaire des fibres nerveuses puis est transmise au cerveau. Les molécules odorantes peuvent tout aussi bien provenir de la bouche que de l’air ambiant inhalé par les narines (voir figure). En effet, dans le milieu chaud et humide de la bouche, les aliments mastiqués émettent de nombreuses molécules odorantes qui parviennent à la cavité nasale en empruntant une sorte de passage secret à l’arrière de la bouche : la voie rétro-nasale. C’est pourquoi la perte d’odorat entraîne une diminution considérable des sensations que l’on a en mangeant.
Les virus, comme celui de la grippe et vraisemblablement le SARS-CoV-2, provoquent une réaction inflammatoire qui dégrade les cellules olfactives ainsi que les fibres nerveuses qui y sont connectées. L’odorat s’en retrouve diminué ou transitoirement supprimé. Différents laboratoires ont fait état de la capacité théorique du virus SARS-CoV-2 à pénétrer dans les cellules du cerveau, mais à ce jour il n’a pas été démontré que c’était effectivement le cas chez les patients.
Une étude européenne menée sur plusieurs centaines de patients montre que la perte de goût serait, comme la perte d’odorat, un des symptômes de la Covid-19. Dans ce cas c’est la perception des saveurs (salé, sucré, acide, amer) qui est altérée. Mais les mécanismes expliquant la perte ou les troubles du goût ne sont pas encore compris.
De nombreux témoignages, dans différents pays, font état d’une perte d’odorat, accompagnée ou non d’une altération du sens du goût, chez des patients atteints de Covid-19. La proportion des personnes touchées semble même assez élevée. C’est pourquoi on utilise ces symptômes pour aider au diagnostic de Covid-19.
La perte d’odorat suite à une infection est un phénomène bien connu dans différentes pathologies communes, comme le rhume ou la grippe saisonnière. Un cas a également été décrit chez un patient atteint lors de l’épidémie de SRAS en 2003. La plupart du temps, cette perte est transitoire et la récupération se fait dans des délais très variables, de quelques jours à plusieurs années selon les patients.
L. Le SARS-CoV-2 fait-il perdre l’odorat ?
Olfaction directe et rétro-olfaction : deux trajets possibles pour les molécules odorantes.
© J. Mihoubi/Universcience


K. Comment peut-on guérir sans traitement ?
Sans traitement, une majorité des malades de la Covid-19 parvient tout de même à guérir. Comment font-ils ? Quand nous tombons malades et que nous guérissons « naturellement », c’est-à-dire sans traitement spécifique, c’est parce que notre organisme possède un ensemble de mécanismes permettant de lutter contre l’infection : la réponse immunitaire. Elle se déroule en deux temps ; d’abord se déclenche l’immunité innée puis vient l’immunité adaptative. La première est immédiate, la seconde particulièrement efficace.
Dès qu’un microbe étranger pénètre dans l’organisme, les cellules de l’immunité innée, présentes comme des sentinelles, détectent l’intrus en repérant des éléments de son matériel génétique ou bien des molécules présentes à sa surface. Elles secrètent des substances chimiques qui alertent de nouvelles cellules de l’immunité afin qu’elles viennent en renfort, et attirent des cellules de l’inflammation qui vont aider leur passage et déclencher un processus d’ingestion et de digestion du microbe, processus qu’on appelle la phagocytose.
Si le microbe est déjà connu de l’organisme et qu’il est encore « en mémoire », l’immunité acquise se déclenche également très vite et agit de façon très efficace contre le microbe. Ce n’est malheureusement pas le cas à l’égard du SARS-CoV-2, qui est nouveau pour nous tous. L’immunité acquise est, dans ce cas, plus lente à s’amorcer. Des morceaux de microbe issus de la phagocytose permettent de déclencher une sélection des globules blancs les mieux adaptés pour lutter contre le microbe. Ils se multiplient et certains produisent en grande quantité des anticorps spécifiques contre le microbe, capables de le neutraliser. Certaines cellules intervenues dans ce processus persistent longtemps après l’élimination du microbe et permettent d’en garder la mémoire.
Pour la Covid-19, il a été démontré que les patients qui guérissent ont produit des anticorps dirigés contre le virus dans leur sang. La durée pendant laquelle notre corps peut continuer de les produire n’est cependant pas encore connue. C’est d’ailleurs l’un des enjeux de la vaccination actuelle : obtenir un vaccin qui procurera une immunité adaptative pour une durée la plus longue possible. Les chercheurs proposent également de développer une sérothérapie dirigée contre le SARS-CoV-2, consistant à récupérer des anticorps dans le sang de patients guéris pour les injecter chez les patients aux symptômes graves afin d’aider leur immunité à lutter efficacement contre le virus.
©selvanegra/iStock / Getty Images PlusPlus
J. Quels traitements contre le SARS-CoV-2 ?
À ce jour, il n’y a pas encore de traitement curatif contre le SARS-CoV-2. Le protocole médical de prise en charge des patients atteints vise à atténuer les symptômes en diminuant la fièvre ou en utilisant des appareils d’assistance respiratoire. Cette approche est très utile, car elle permet de soulager les symptômes du patient tout en donnant le temps à son système immunitaire de le guérir (voir question K).
Des anticoagulants ont été ajoutés à cet arsenal quand on a compris que le virus pouvait provoquer la coagulation du sang (voir question H). Mais le premier médicament ayant montré un bénéfice conséquent en termes de mortalité au cours d’un essai clinique d’ampleur est un corticoïde déjà utilisé dans des affections pulmonaires : la dexaméthasone. Cette molécule réduit la mortalité chez des patients atteints d’une forme sévère de la Covid-19 et nécessitant un apport en dioxygène. Un tiers des patients sous ventilation mécanique est concerné. En revanche, elle ne montre aucun bénéfice sur des patients souffrant d’une atteinte faible à modérée.
L’efficacité de la dexaméthasone tient notamment dans sa capacité à contrer l’inflammation exagérée caractéristique d’un certain nombre de cas graves de Covid-19 (voir question O). Comme les autres corticoïdes, elle agit en pénétrant dans les cellules et en modifiant leur activité : les cellules immunitaires produisent moins de facteurs favorisant l’inflammation et, pour certaines, plus de molécules anti-inflammatoires. Si l’on se rappelle que l’inflammation est une réaction défensive de l’organisme, on comprend alors qu’un usage trop précoce de la dexaméthasone pourrait empêcher le système immunitaire de s’opposer à la multiplication du virus. C’est une explication probable de son absence d’efficacité sur les patients non gravement atteints, voire de l’apparition d’effets favorisant la maladie. Donné trop tôt, il affaiblit nos défenses, donné plus tard, il limite l’inflammation démesurée et devient bénéfique. Voilà pourquoi il est fondamental de déterminer précisément la dose et le stade de la maladie où ce médicament doit être administré. Le traitement contre la Covid-19 s’apparente de plus en plus à une combinaison de molécules ciblant à la fois le virus et le système immunitaire selon un tempo qui doit être parfaitement déterminé.
I. Comment une maladie peut-elle passer de l’animal à l’homme ?
Quand un micro-organisme, présent initialement dans la faune sauvage ou domestique, provoque une maladie infectieuse humaine, on appelle cela une zoonose. Pour qu’elle émerge, une première transmission Cette transmission d’animal à homme doit avoir lieu. Cela implique une rupture de la barrière d’espèce, c’est-à-dire que le micro-organisme en évoluant et à force de contacts répétés avec le nouvel hôte parvient à s’y développer. L’histoire est jalonnée d’exemples : la maladie à virus Ebola, le SIDA ou encore la grippe aviaire.
À l’origine, un micro-organisme est particulièrement adapté à une ou plusieurs espèces. C’est le cas de bon nombre de coronavirus dont on sait qu’ils sont établis et circulent chez les chauves-souris. Celles-ci ont la particularité d’héberger ces virus sans en être malades car elles sécrètent en permanence des interférons (voir question N). Elles constituent donc un très bon « réservoir ». Passer d’un réservoir primaire, comme la chauve-souris, à un nouvel hôte implique une combinaison d’évènements. Des sauts sporadiques peuvent avoir lieu : un virus passe accidentellement entre individus d’espèces différentes qui n’ont pas nécessairement de symptôme. Ces opportunités de transmission sont favorisées par des changements climatiques ou des modifications d’écosystèmes, comme la déforestation. Cela crée des contacts entre espèces qui ne se seraient pas produits sinon. De plus, les épidémies liées aux coronavirus mettent en évidence le rôle clé d’un autre animal faisant l’intermédiaire entre l’espèce réservoir et l’humain. Il s’agit souvent d’un animal dont la rencontre avec l’humain est plus fréquente, comme la civette lors de l’épidémie de SRAS en 2002 ou le dromadaire pour l’épidémie persistante de MERS.
Mais ces occasions de transmission ne suffisent pas à elles seules pour expliquer la rupture d’une barrière d’espèce. La compatibilité du virus avec le nouvel hôte est également déterminante dans sa capacité à l’infecter efficacement et à se transmettre ensuite d’individu à individu. Ces aptitudes peuvent s’acquérir de manière aléatoire à mesure que des changements, des mutations, dans le matériel génétique du virus apparaissent. Les coronavirus sont particulièrement prompts à muter. Couplés aux changements démographiques et aux mouvements de population, ces mécanismes participent du déclenchement ponctuel d’épidémies, voire de pandémies comme nous le voyons aujourd’hui avec la Covid-19.

H. Pourquoi le virus ne s’attaque qu’à certains organes ?
Les virus ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Pour se répliquer, ils ont besoin d’infecter les cellules d’un hôte. Pour cela, les virus ont à leur surface des protéines qui sont de véritables clés d’entrée. En effet, nos cellules possèdent une membrane qui joue le rôle d’une frontière, hautement contrôlée, entre l’intérieur et l’extérieur. Pour autant, les cellules ont naturellement besoin de faire entrer des éléments nécessaires pour elles (comme des acides aminés récupérés après la digestion d’un repas) ou de libérer dans le corps des éléments qu’elles produisent. Ces échanges sont finement régulés par des récepteurs présents à la surface de la cellule. Mais comme les besoins des organes sont différents, les récepteurs de leurs cellules ne sont pas les mêmes. Par exemple une cellule de foie n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes récepteurs qu’une cellule de poumon.
Pour qu’un virus soit pathogène pour l’humain, il doit posséder en surface des protéines capables de se lier à des récepteurs présents sur des cellules humaines. Chez les coronavirus, ces protéines sont les « spicules ». Elles forment une sorte de couronne autour du virus (d’où son nom, « corona » signifiant couronne en latin). Du côté des cellules, les récepteurs de ces spicules sont appelés ACE2. Toute cellule qui possède à sa surface des récepteurs ACE2 est donc susceptible d’être infectée. C’est le cas des cellules qui tapissent le nez et la gorge : ce sont les premières infectées, d’autant mieux qu’elles sont facilement accessibles (voir question E). De là, le virus gagne les cellules des alvéoles pulmonaires (voir question A) également pourvues du récepteur ACE2. Puis il peut provoquer la coagulation du sang en infectant les cellules constituant les parois des petits vaisseaux sanguins ayant des récepteurs ACE2. Et c’est également le cas des cellules du cœur, de l’intestin et du rein, que le virus peut donc aussi atteindre.
©NIAID
G-bis. Comment a-t-on pu gagner du temps pour trouver un vaccin contre la Covid-19 ?
Contre le SARS-CoV-2, les vaccins sont élaborés dans un temps record, qu’ils soient à ARN ou plus traditionnels. De nombreuses entreprises se sont lancées dans la course avec une seule certitude, acquise lors des recherches sur le virus SARS-CoV-1 : le vaccin doit cibler le spicule S. Pour gagner du temps, la plupart ont mis en œuvre la technique dans laquelle elles ont développé une expertise. Mais fabriquer un vaccin atténué, à vecteur ou sous-protéique prend du temps (voir question U). C’est là que le vaccin à ARN messager a fait la différence : cette molécule est facile à synthétiser.
Ensuite, quel que soit le type de vaccin, les étapes suivantes ont été raccourcies : au lieu de se succéder, les trois phases de recherche clinique se superposent. Pour ces tests, les cohortes à grande échelle sont rapidement constituées car les volontaires ne manquent pas. Si le vaccin s’avère prometteur, les industriels lancent sa production avant même les conclusions définitives des essais. Le risque financier est énorme. Mais il est couvert, en grande partie, par les précommandes considérables des États. Enfin, l’étude des dossiers a été une priorité des grandes agences du médicament. Beaucoup d’obstacles ont donc été levés mais plusieurs questions demeurent. Quelle sera l’efficacité du vaccin sur la population entière et combien de temps durera la protection qu’il procure ?
G. Pourquoi mettre au point un vaccin prend-il habituellement si longtemps ?
La mise au point d’un vaccin se fait en plusieurs étapes. En premier lieu il faut comprendre comment le microbe fonctionne : comment il infecte et ce qui le rend pathogène. Ensuite il faut choisir le type de vaccination. Par exemple, cherche-t-on à atténuer la virulence du microbe ? Utilisons-nous un vaccin existant en essayant de l’adapter (voir question F) ? Une fois un prototype prometteur obtenu, viennent les premières étapes de test en laboratoire. Le vaccin est testé en
« préclinique » sur des cellules en culture, donc in vitro, puis in vivo sur un petit animal et enfin sur les singes. Il faut vérifier à chaque étape que le vaccin provoque bien une production d’anticorps et de lymphocytes T protecteurs et qu’il n’entraîne pas d’effets secondaires.
Les tests sur populations humaines peuvent alors commencer, on parle ici de phase de recherche clinique. Pour ce faire, des cohortes de volontaires compatibles avec ces tests doivent être recrutées. Il s’agit, à ce stade, de démontrer que l’injection du vaccin ne provoque pas d’effets secondaires, de trouver le juste dosage, le bon rythme des injections successives et de vérifier que les personnes vaccinées produisent bien des anticorps contre le microbe. Une dernière validation à grande échelle du vaccin ne peut être faite que sur une grande cohorte de patients vaccinés. Toutes ces étapes prennent du temps, généralement deux à cinq ans, parfois dix ans ! Suite à sa commercialisation, le vaccin est dans son ultime phase, celui de son suivi au fil des années chez les patients.

F. Quelles pistes de vaccin suit-on contre
le Covid-19 ?
Quand nous « tombons malades » et que nous « guérissons », c’est le résultat d’une rencontre entre un microbe et notre système immunitaire (voir question K). Les vaccins utilisent ce phénomène. Lorsque notre système immunitaire défend notre organisme, il a plusieurs cordes à son arc. L’une d’elles est de produire des anticorps neutralisants, qui vont spécifiquement bloquer l’action d’un microbe donné en se fixant sur lui. L’avantage de ce mécanisme de défense est qu’il peut rester « en mémoire » dans notre organisme : les cellules qui produisent les anticorps spécifiques à certains microbes peuvent rester plusieurs années (voire des décennies) dans notre corps, prêtes à répondre encore plus rapidement à la prochaine intrusion de ces mêmes microbes. Cette mémoire explique que nous n'attrapons qu'une seule fois certaines maladies infantiles, comme la rubéole ou les oreillons. Si le même virus attaque une deuxième fois il est immédiatement neutralisé . La vaccination repose sur ce principe de « défense » et de « mémoire ».
Vacciner consiste à simuler une première rencontre entre un microbe et nos cellules de l’immunité, mais sans provoquer la maladie. Si le microbe se présente ensuite, la réponse, notamment de nos anticorps, sera rapide, plus efficace et notre corps mieux protégé. Un des moyens pour créer un vaccin est d’identifier des composants microbiens capables de déclencher la mise en place d’une telle mémoire immunitaire. Pour la recherche d’un vaccin contre le SARS-CoV-2, on gagne du temps en exploitant les travaux réalisés sur le virus SARS-CoV-1, responsable de l’épidémie de 2003, car les spicules qui recouvrent ces deux virus sont très similaires. Aussi appelées protéines S, ils permettent au virus d’entrer dans les cellules cibles (voir question H). Or, des expériences menées in vitro et chez l’animal montrent que des anticorps spécifiques peuvent être produits et bloquer l’entrée du virus dans les cellules en se fixant sur les spicules du SARS-CoV-1. Cela ouvre une piste prioritaire pour la recherche vaccinale contre le SARS-CoV-2.
Parmi plus de 200 candidats vaccins, dont une soixantaine sont en phase clinique, différentes techniques sont utilisées. Il s’agit de mettre en contact ces spicules du SARS-CoV-2 avec l’organisme afin qu’il produise des anticorps dirigés contre eux. Pour ce faire, les approches classiques consistent à injecter ces protéines S. Mais la première technique à recevoir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché en Europe se base sur une autre stratégie : faire fabriquer temporairement la protéine S par nos propres cellules.
©Sergei Anischenko/iStock/Getty Images Plus
Pour contenir ou ralentir la propagation du virus, il est essentiel de connaître ses voies de transmission. Le SARS-CoV-2 se transmet de personne à personne et essentiellement de deux façons : par contact et par voie aérienne. Le virus prolifère dans les tissus de l'arbre respiratoire et se retrouve ensuite dans les sécrétions respiratoires. Il sort de l’organisme sous forme de gouttes de liquide que l’on peut émettre en parlant, avec une portée d'environ 2 mètres, et plus loin encore quand on tousse ou que l’on éternue. Les gouttelettes contenant du virus sont projetées dans l’air puis retombent sur les surfaces. Un sujet sain à proximité peut les inhaler et être infecté. Des microgouttelettes, appelées aérosols, peuvent rester plus longtemps en suspension dans l’air avant de retomber, voire être entraînées par des courants d’aération. On ne sait pas combiend e temps le virus reste infectieux dans de telles conditions, mais il est recommandé aux personnes saines de porter un masque pour se protéger des aérosols. La transmission émane de toute personne infectée par le virus, quand bien même elle n’a pas encore déclaré la maladie ou qu’elle reste asymptomatique. Le port du masque est donc également conseillé pour éviter de contaminer les autres en arrêtant physiquement une partie des gouttelettes émises.
Une fois retombées, les gouttelettes émises par une personne déjà infectée se retrouvent sur la peau, les mains et les objets qu’elle a touchés. Il a été démontré en conditions contrôlées au laboratoire que les virus peuvent demeurer actifs hors d’un sujet porteur de quelques heures à quelques jours. Pour le SARS-CoV-2, cette durée semble dépendre de la nature de la surface et augmenter avec l’humidité (voir question M). En touchant les surfaces souillées, un sujet sain se retrouve exposé. Le virus ne rentre pas par la peau mais par le contact des mains sur le nez ou la bouche si elles n’ont pas été lavées. Les scientifiques examinent également la possibilité d’une voie d’entrée par le frottement des mains sur les yeux.
Pour certaines pathologies virales, dont la Covid-19, il existe des personnes infectées qui transmettent le virus à un grand nombre de sujets sains. On parle alors d’événements de « super-propagation ». Cela peut notamment se produire si ces personnes sont entrées en contact avec un grand nombre de sujets, par exemple lors d’un rassemblement, ou si elles possèdent une concentration de virus (charge virale) exceptionnellement élevée. En Corée du Sud, les autorités sanitaires ont examiné l’emploi du temps des premiers cas avérés de Covid-19 et rapportent qu’un de ces cas, avant d’avoir été dépisté positif, a participé à deux rassemblements au sein desquels plus de 1 000 personnes ont ensuite été testées positives.
E. Comment limiter la transmission ?
Non, la maladie Covid-19 est différente de la grippe. Et la comparaison est encore plus trompeuse si l’on confond la grippe pandémique, très rare, et la grippe saisonnière qui circule d’un hémisphère de la planète à l’autre et y séjourne tous les ans tant que les conditions y sont hivernales. Cette dernière est, en général, sans conséquence grave, mais occasionne, notamment chez les personnes âgées, une surmortalité qu’on estime tout de même entre 290 000 et 650 000 décès chaque année dans le monde. Les traitements antiviraux et la vaccination empêchent que le bilan ne soit plus lourd.
De son côté, la grippe pandémique est causée à chaque fois qu’un nouveau sous-type de virus apparaît. La « grippe espagnole » de 1918-1919 était causée par un virus H1N1, la grippe asiatique de 1957-1958, par un virus H2N2, et en 2009 un nouveau virus H1N1 s’est propagé. À l’origine de ces épidémies, il y a un transfert d’une espèce animale à l’humain (passage de la barrière d’espèce), puis le virus se propage par contamination interhumaine. Le nouveau virus peut alors infecter une population humaine plus élargie car elle est dépourvue d’anticorps contre lui.
La grippe pandémique est donc un bon modèle pour les épidémiologistes qui cherchent à prédire l’évolution de la maladie Covid-19, mais ils doivent prendre en compte les différences biologiques qui existent entre les deux types de virus. En effet ils appartiennent à des familles distinctes, ne se fixent pas sur les mêmes récepteurs cellulaires de l’hôte et agissent donc différemment. C’est pourquoi il faut rechercher d’autres traitements antiviraux contre la Covid-19.
D. La maladie Covid-19, c’est une grosse grippe ?
Cette question est cruciale pour savoir s’il existe, ou pas, une forme d’immunité contre ce virus dans l’espèce humaine. Si ce n’est pas le cas on parle de virus émergent, soit parce qu’il provient d’un ancien virus qui aurait suffisamment changé par mutation, soit parce qu’il était jusqu’alors inconnu chez l’humain. Le SARS-CoV-2 relèverait du deuxième cas. La plupart des virus émergents (HIV, Ebola, SARS-CoV, MERS-CoV) viennent de réservoirs animaux, c'est à dire d'animaux qui hébergent ces virus sans en être malades.
C. Le SARS-CoV-2 et l’humain viennent-ils de se rencontrer ?
Même s’il existe d’autres coronavirus, celui-ci possède des différences génétiques suffisamment grandes pour être considéré comme nouveau. Par ailleurs, le matériel génétique des coronavirus est connu pour accumuler des changements par mutations au cours du temps. Or, les scientifiques ont démontré que les échantillons du virus SARS-CoV-2 provenant de différents patients étaient génétiquement très proches : le virus n’a donc pas encore eu le temps d’accumuler beaucoup de mutations depuis qu’il est capable d’infecter notre espèce. Ainsi, il est très probable que ce virus n’ait qu’une seule origine animale et n’ait infecté que depuis très récemment l’humain, qui n’avait donc pas d’immunité préexistante.

©Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
B-bis. Tests Covid-19 : pourquoi existe-t-il différentes voies de prélèvement ?
Pour déterminer si une personne est porteuse du SARS-CoV-2, on prélève des sécrétions provenant des voies respiratoires, car c’est là que le virus se loge et se multiplie. Mais il n’est pas présent partout de façon équivalente. On le trouve en abondance dans le pharynx (voir figure).
La fiabilité du test est donc la meilleure quand le prélèvement est effectué en introduisant un écouvillon (grand coton-tige) par la narine, le long du plancher nasal jusqu’à la muqueuse du nasopharynx. L’écouvillon est ensuite placé dans un tube contenant un milieu liquide de conservation et sa tige est cassée de façon à fermer le tube. L’acte de prélèvement est désagréable sans être réellement douloureux, mais il peut être difficile à réaliser ou très mal vécu chez certains patients (enfants, personnes présentant des troubles psychiatriques, personnes très âgées). Dans ce cas il est possible d’atteindre le pharynx par la gorge (voie oropharyngée), ce qui est moins désagréable mais peut provoquer un réflexe nauséeux.
On peut également réaliser un prélèvement de salive, par simple crachat du patient ou à l’aide d’une pipette introduite dans la bouche, ce qui est beaucoup plus simple et moins désagréable. Cependant la concentration de virus est beaucoup plus faible dans la bouche que dans le pharynx. Ce mode de prélèvement est donc réservé aux personnes qui présentent des symptômes depuis moins de 7 jours, car c’est dans cette phase de la maladie que la quantité de virus est la plus élevée. De plus, un résultat négatif ne garantit pas une absence de virus, ce mode de prélèvement étant moins sensible que les autres. Les tests salivaires doivent être ensuite analysés par la méthode RT-PCR (voir question B), la plus efficace.


© Ketpixel/iStock/Getty Images Plus
Depuis l’identification du génome du SARS-CoV-2, en un temps record, dès le mois de janvier 2020, plusieurs tests ont été mis au point. Pour détecter la présence du virus dans un prélèvement, deux méthodes sont mises en œuvre : la RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase associée à une transcription inverse) et le test antigénique.
La première permet de détecter des quantités extrêmement faibles de virus mais nécessite d’acheminer le prélèvement depuis le laboratoire vers un plateau technique. Après y avoir inactivé le virus en le chauffant, son matériel génétique, l’ARN, est extrait puis mis au contact d’enzymes qui en font un très grand nombre de copies. C’est pourquoi de très faibles quantités du matériel génétique du virus peuvent être ainsi détectées. Pendant cette phase de réplication, si le virus était présent dans le prélèvement, on observe la fluorescence émise par l’échantillon qui augmente régulièrement avec le nombre de copies. Cette méthode est coûteuse en temps, en matériel et en personnel.
Plus rapide (de 10 à 30 minutes) mais moins sensible, le test antigénique révèle la présence de la protéine S, située sur l’enveloppe du virus, ou de la protéine N, située à l’intérieur. Ces protéines sont également appelées
« antigènes ». Le prélèvement est mélangé à des anticorps qui ne se combinent qu’avec la protéine ciblée, si elle est présente, et provoquent alors l’apparition d’une bande colorée. Mais la présence du virus n’est révélée ainsi que s’il est présent en grande quantité dans le prélèvement. C’est pourquoi la Haute Autorité de santé recommande de réaliser ces tests rle plus tôt possible et dans un délai maximum de 7 jours après un contact ou l'apparition de symptômes. Au-delà, la quantité de virus présente chez les patients risque d’être trop faible. Le prélèvement est à réaliser dans le nasopharynx car il contient plus de virus que la bouche ou la gorge (voir question B-bis).
La période où l’on est le plus contagieux s’étend de 48 heures avant le début des symptômes jusqu’à 7 jours après. La rapidité des tests antigéniques est donc un atout majeur pour limiter la transmission. En outre, ils permettent de repérer les sujets qui ont une concentration élevée de virus et sont donc potentiellement les plus contagieux.
B. PCR, test antigénique, quelles différences ?
Test RT-PCR : les courbes bleues montrent l’augmentation de fluorescence de tests positifs, la courbe rouge correspond à un prélèvement négatif.
Test antigénique : une bande colorée apparaît à côté de la bande de contrôle si le test est positif.

©D. Calma/IAEA

©Moritz Thibaud/ABC/Andia.fr
La maladie Covid-19 se manifeste par une pneumonie particulière. Une pneumonie est une infection des poumons qui apparaît brutalement. Les alvéoles des poumons se remplissent alors de pus et de liquide au lieu de se gorger d’air pour fournir le dioxygène au sang (voir figure). Cela provoque de la fièvre et une toux importante, rend la respiration difficile et douloureuse et limite notamment l’apport d’oxygène à l’organisme.
A. Quel rapport entre la Covid-19 et la pneumonie ?
Généralement les pneumonies sont causées par la prolifération d’une bactérie, comme le pneumocoque, ou d’un virus, comme celui de la grippe influenza ou le récent SARS-CoV-2 provoquant la maladie Covid-19. Dans le cas des bactéries, les alvéoles touchées sont généralement très localisées dans une partie du poumon, tandis qu’une pneumonie virale est, en général, plus étendue : ces différences seront donc visibles en réalisant un scanner des poumons. Mais pour identifier formellement le virus il faut réaliser un prélèvement. (voir question Bbis)

© J. Mihoubi/Universcience

#LaScienceEstLà
Transmission, traitement, vaccin, recherches en cours... En 23 questions-réponses, l’exposition « Coronavirus : ce que sait la science ! » propose une revue du savoir, simple et accessible, sur l’épidémie de Covid-19.
Les sciences nous aident à comprendre le monde et la culture scientifique doit aller à la rencontre de tous. En cette période de crise sanitaire, le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie repensent leurs offres et vous proposent cette exposition virtuelle gratuitement, en ligne et en téléchargement. Pour une viralité du savoir avant tout ! #LaScienceEstLà #CultureChezNous
Centre de science, collectivité, centre d’accueil… : vous pouvez télécharger librement cette exposition en version imprimable au format .pdf (23,5 Mo), afin de la mettre à disposition de vos publics et du plus grand nombre.
Si vous souhaitez la version de cette exposition en « haute définition », proposer une adaptation ou une traduction en langue étrangère, nous sommes à votre écoute et serons heureux d’en faire profiter le plus grand nombre.
Votre contact : DITI@universcience.fr
Coronavirus :
ce que sait la science !

© NIAID-RML
informations mises à jour le 14/01/2021