
Hannibal franchissant les Alpes
Bonaparte franchissant les Alpes
Les hommes ont toujours franchi les Alpes
Les difficultés de franchissement
et de circulation qu'offrent les montagnes, ont été à
la fois un obstacle et un atout pendant de longs siécles.
La montagne obstacle, inaccessible, infranchissable, va servir de frontière aux entités politiques qui se mettent en place, et de lieu de protection pour les sociétés persécutées. Aujourd'hui encore, les montagnes marquent bien souvent la frontière entre les Etats. La franchir a longtemps été un exploit qui permettait parfois de surprendre l'adversaire : Hannibal et ses éléphants, Bonaparte et ses hussards. |
Hannibal franchissant les Alpes |
Bonaparte franchissant les Alpes |
|
Avalanche sur un convoi muletier |
La diligence Lyon-Turin à Lanslebourg au début du XIXème siècle |
|
|
|
Le chemin de fer du Mont-Cenis 1868 |
|
Les progrès des techniques de construction alliés au développement de la sidérurgie permettent la réalisation de percées héroïques alliant tunnels et ponts audacieux. Ces exploits défraient la chronique de l'époque, glorifiant les Etats qui les réalisent et la technologie qui les rend possibles. Ce sont des défis techniques et humains qu’a représenté le percement des premiers tunnels ferroviaires à la fin du XIXe et au début du XXe siècles (chemin de fer Fell sur le mont Cenis en 1868; Fréjus 1871; Saint-Gothard 1882 ; Simplon 1906 et 1922 ; Lötschberg 1913).
|
Trois générations de franchissement des Alpes :
- les tunnels d’altitude qui, moins élevés que les cols, ont permis, d’abord au chemin de fer puis à la route, un franchissement plus rapide : 12 kms pour le tunnel du Fréjus en 1871 à 1300 mètres d’altitude ; 14,8 kms pour le Saint-Gothard en 1882 à 1150 mètres d’altitude ; 19,8 kms pour le Simplon en 1906 mais à 700 mètres d’altitude), puis à l’autoroute : Grand-Saint-Bernard 1964, Mont-Blanc 1965 ; Petit-Saint Bernard 1967 ; Brenner 1972 ; Fréjus et Saint Gothard 1980. - les tunnels de base, qui, au début de ce XXIème siècle, vont permettre à de longs trains (fret et voyageurs), de franchir les Alpes à grande vitesse grâce à des percées à basse altitude, soit 500 à 700 m, peu pentues et à large gabarit, et ainsi de rattraper, face à l’augmentation des trafics le retard pris par le rail par rapport à la route depuis plus d’un siècle. |
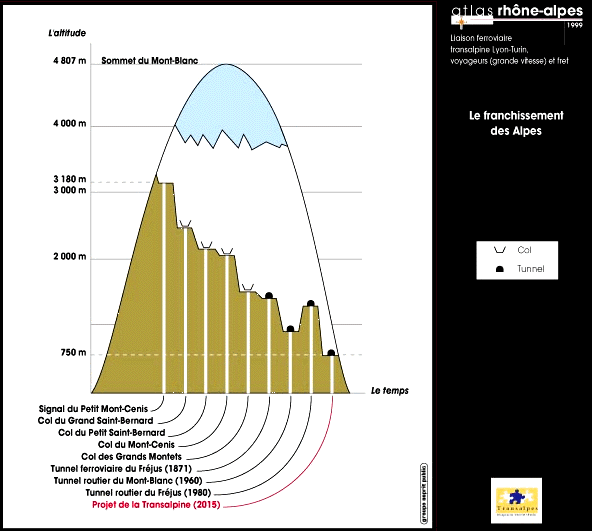 |
Question :
Montrer à partir des différents documents de cette page que les Alpes n'ont jamais été une barrière infranchissable.