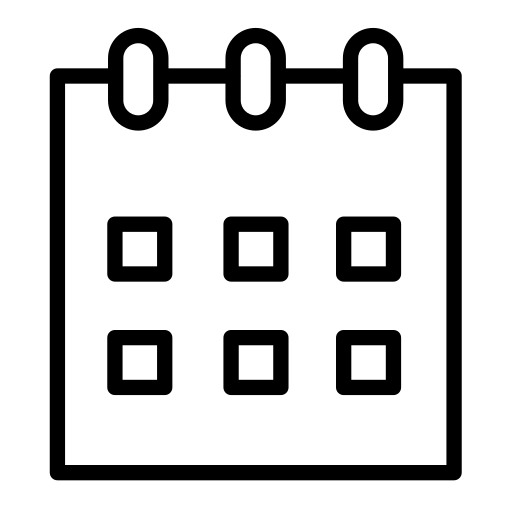Alors que les cas de mpox (variole du singe), se multiplient et interrogent, la Cité de la santé vous propose des éléments de réponse à travers une sélection de sites, de dossiers et de questions fréquentes.
QU’EST-CE QUE LA MPOX (variole du singe) ?
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis à jour un dossier complet Variole simienne (mpox), le 26 août 2024 :
La mpox, anciennement désignée sous le nom de « variole du singe », est une maladie virale causée par l’orthopoxvirus simien, qui appartient au genre Orthopoxvirus.
[…]
La mpox est une maladie infectieuse qui peut provoquer une éruption cutanée douloureuse, un gonflement des ganglions lymphatiques, de la fièvre, des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales et un manque d’énergie. La plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement, mais certaines peuvent contracter des formes graves de la maladie.La mpox est causée par l’orthopoxvirus simien. Il s’agit d’un virus à ADN double brin enveloppé du genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae, à laquelle appartiennent les virus de la variole, de la variole de la vache et de la vaccine, entre autres.
Transmission
La mpox se transmet d’une personne à l’autre, principalement par contact étroit avec une personne atteinte, y compris au sein d’un même foyer. On entend par contact étroit le contact peau à peau (comme toucher quelqu’un ou avoir des rapports sexuels) et le contact bouche à bouche ou bouche à peau (embrasser quelqu’un), mais aussi le fait de se trouver en face de quelqu’un (parler ou respirer à proximité et ainsi être en contact avec des particules respiratoires infectieuses).
Les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels sont plus à risque de contracter la mpox.
La maladie se transmet aussi par le biais d’objets contaminés, comme des vêtements ou des draps, par blessure par piqûre d’aiguille dans le cadre de soins de santé, ou dans des établissements communautaires, tels que des salons de tatouage.
Pendant la grossesse ou l’accouchement, le virus peut être transmis au bébé. L’infection par le virus de la mpox au cours de la grossesse peut être dangereuse pour le fœtus ou le nouveau-né et peut entraîner une perte de grossesse, une mortinaissance, le décès du nouveau-né ou des complications pour la mère.
La transmission du virus de la mpox d’un animal contaminé à un humain peut survenir à l’occasion de morsures ou de griffures ou lors d’activités telles que la chasse, le dépouillage, le piégeage, la cuisson, la manipulation des carcasses ou la consommation d’animaux. On ne connaît pas le réservoir animal du virus, mais des études sont en cours. […]
Signes et symptômes
Les signes et symptômes de la mpox apparaissent habituellement dans la semaine qui suit la contamination, mais ils peuvent survenir entre un et 21 jours après l’exposition au virus. Si les symptômes durent généralement entre deux et quatre semaines, ils peuvent mettre plus de temps à disparaître chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.
Les symptômes habituels de la mpox sont :
- une éruption cutanée ;
- de la fièvre ;
- des maux de gorge ;
- des céphalées ;
- des douleurs musculaires ;
- des douleurs dorsales ;
- un manque d’énergie ; et
- un gonflement des ganglions lymphatiques.
Chez certaines personnes, l’éruption cutanée est la première manifestation de la maladie tandis que, chez d’autres, la fièvre, les douleurs musculaires et les maux de gorge peuvent apparaître en premier.
Souvent, l’éruption cutanée apparaît d’abord sur le visage, puis gagne tout le corps, jusqu’à la paume des mains et la plante des pieds. Elle peut aussi apparaître sur d’autres parties du corps où le contact avec le virus a eu lieu, comme les organes génitaux. Elle commence par une lésion plate, qui se transforme ensuite en vésicule pleine de liquide et qui peut être source de démangeaisons ou de douleurs. En guérissant, la lésion forme une croûte qui se dessèche et finit par tomber.Certaines personnes ne présentent qu’une seule lésion ou très peu, tandis que d’autres en ont des centaines, voire plus.
Les lésions peuvent apparaître n’importe où sur le corps, par exemple :
- sur la paume des mains et la plante des pieds ;
- sur le visage, la bouche ou la gorge ;
- à l’aine et sur les organes génitaux ; et
- sur l’anus.
De plus, certaines personnes présentent un gonflement douloureux du rectum (proctite) ou des douleurs et des difficultés à uriner (dysurie) ou lors de la déglutition.
Les personnes atteintes de la mpox peuvent transmettre le virus tant que leurs lésions ne sont pas guéries et qu’une nouvelle couche de peau ne s’est pas formée. Certaines personnes peuvent être infectées, mais ne présenter aucun symptôme. Si des cas d’infection par une personne asymptomatique (ne présentant pas de symptômes) ont été signalés, on dispose de peu d’informations sur la fréquence de ce type de transmission.
Les enfants, les personnes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, y compris les personnes présentant une infection à VIH mal contrôlée, sont davantage à risque de contracter une forme grave de la mpox et de mourir des suites de complications.
Certaines personnes peuvent développer une forme grave de la mpox. La maladie peut notamment entraîner des infections bactériennes cutanées avec formation d’abcès et de lésions cutanées graves.
D’autres complications peuvent survenir, par exemple : une pneumonie ; une infection de la cornée avec une perte de vision ; des douleurs ou des difficultés lors de la déglutition ; des vomissements ou des diarrhées avec pour conséquence une déshydratation ou une malnutrition ; et une infection du sang (septicémie) ou une inflammation du cerveau (encéphalite), du cœur (myocardite), du rectum (proctite), des organes génitaux (balanite) ou des voies urinaires (urétrite). La mpox peut être mortelle dans certains cas.
Diagnostic
Le dépistage de la mpox peut s’avérer difficile, car d’autres infections et maladies peuvent lui ressembler.
Il est important de distinguer la mpox de la varicelle, de la rougeole, des infections cutanées bactériennes, de la gale, de l’herpès, de la syphilis, d’autres infections sexuellement transmissibles et des allergies associées aux médicaments. Une personne atteinte de la mpox peut présenter une autre infection sexuellement transmissible concomitante, comme la syphilis ou l’herpès. De même, un enfant potentiellement contaminé par le virus de la mpox peut aussi avoir contracté la varicelle. Les tests sont donc essentiels pour traiter les personnes contaminées le plus rapidement possible, pour empêcher les formes graves de la maladie et pour prévenir la propagation du virus.
La détection de l’ADN viral par amplification en chaîne par polymérase (PCR) est le test de laboratoire à privilégier pour la mpox. Les meilleurs échantillons diagnostiques sont prélevés directement sur l’éruption – peau, liquide ou croûtes – et collectés par frottis vigoureux. En l’absence de lésions cutanées, des tests peuvent être effectués sur des écouvillons pharyngés et anaux.
Les tests sanguins ne sont pas recommandés. Les méthodes de détection des anticorps ne sont pas forcément utiles, dans la mesure où elles ne permettent pas de faire la distinction entre plusieurs orthopoxvirus.Le dépistage du VIH devrait être proposé aux adultes et, selon qu’il convient, aux enfants atteints de la mpox. Dans la mesure du possible, il faudrait réaliser des tests de diagnostic d’autres maladies, par exemple varicelle-zona, syphilis et herpès.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mpox
Les questions que vous vous posez, les réponses du Ministère de la santé : Virus mpox : Questions-Réponses (mise à jour 07/01/25)
1 – Qu’est-ce que le mpox et quels en sont les symptômes ?
Le mpox est une maladie infectieuse, qui se caractérise notamment par une éruption cutanée qui peut être isolée ou précédée ou accompagnée d’une fièvre ou de ganglions. mpox est une zoonose, c’est à dire une maladie transmise de l’animal à l’humain (rongeurs). La transmission est également interhumaine.
L’infection par le virus mpox peut provoquer une éruption, faite de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement, la formation de croûtes puis la cicatrisation. Si les vésicules se concentrent plutôt sur le visage, dans la zone ano-génitale, les paumes de mains et les plantes des pieds elles peuvent être présentes sur l’ensemble du corps ainsi que les muqueuses, notamment buccales et ano-génitales. Dans ces dernières localisations, les lésions peuvent être très douloureuses.
Des démangeaisons peuvent survenir et ces éruptions peuvent s’accompagner de fièvre, de maux de tête, de courbatures et de fatigue. Les ganglions lymphatiques peuvent être enflés et douloureux, sous la mâchoire, au niveau du cou ou au pli de l’aine. Des maux de gorge sont également signalés.
L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours. La phase de fièvre dure environ 1 à 3 jours. La maladie guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 3 semaines mais parfois 4 semaines.
2 – Quels sont les clades du mpox ?
On distingue plusieurs principaux clades :
- Le clade I, à l’origine présent dans le bassin du Congo en Afrique centrale ;
- Le clade I se subdivise en deux sous-clades, Ia et Ib. Le clade I circule historiquement en Afrique centrale ; le clade Ib, découvert en septembre 2023 en République démocratique du Congo (RDC), et plus récemment dans des pays frontaliers de la RDC. Sa transmissibilité et sa létalité sont difficiles à préciser en raison de données épidémiologiques partielles.
- Le clade II, et notamment le sous clade IIb responsable de l’épidémie mondiale de 2022, qui avait également touché la France.
3 – Comment se transmet le mpox ?
Le virus se transmet entre personnes, en particulier la famille et les proches. Les principaux modes de transmissions connus sont :
- Un contact physique rapproché, notamment lors d’un rapport sexuel, par le contact de la peau ou des muqueuses avec les lésions cutanées (boutons ou croûtes), avec une personne infectée
- Le partage de linge (vêtements, draps, serviettes, …), ustensiles de toilette (brosses à dents, rasoirs, …), vaisselle, sextoys, matériel d’injection, etc., contaminés par une personne infectée
- Dans une moindre mesure, par les gouttelettes (postillons, éternuements).
4 – Quelles sont les recommandations en cas de symptômes ?
En cas d’apparition de symptômes (éruption cutanée avec des vésicules avec ou sans fièvre), contactez votre médecin traitant ou un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).En attendant un avis médical, il est recommandé de s’isoler, d’éviter les contacts avec d’autres personnes, et de couvrir les lésions lors du déplacement chez le médecin.
QUELS SONT LES TRAITEMENTS/LA VACCINATION ? QUELLES SONT LES PERSONNES A RISQUE ?
L’OMS explique quels sont les traitements, les groupes à risques et l’intérêt de la vaccination (26/08/24) :
Le traitement de la mpox a pour but de soigner l’éruption cutanée, d’atténuer les douleurs et de prévenir les complications. Il est important de dispenser des soins de soutien rapidement pour soulager les symptômes et éviter d’autres problèmes.
Le vaccin contre la mpox peut contribuer à prévenir l’infection (prophylaxie préexposition).
Il est recommandé aux personnes à risque de contracter la mpox de se faire vacciner, notamment lors d’une flambée épidémique.
Les groupes à risque de contracter la mpox sont :
- les personnels de santé et d’aide à la personne exposés ;
- les personnes vivant sous le même toit qu’une personne atteinte de la mpox ou dans son entourage proche, y compris les enfants ;
- les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels, y compris les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; et
- les travailleurs et travailleuses du sexe et leurs clients.
Le vaccin peut aussi être administré après qu’une personne a été en contact avec une personne atteinte de la mpox (prophylaxie postexposition). Dans ce cas, il doit être administré moins de quatre jours après le contact. Il peut être administré jusqu’à 14 jours après le contact si la personne n’a pas développé de symptômes.
Certains antiviraux ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence dans certains pays et font l’objet d’essais cliniques. À ce jour, il n’existe aucun traitement antiviral efficace prouvé contre la mpox. […]
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mpox
Les réponses du Ministère du travail, de la santé et des solidarités au sujet des traitements et de la vaccination (07/01/25).
Informations générales
5 - Quels sont les traitements ?
Le traitement est symptomatique (anti-douleurs, soins des plaies, …).
Un traitement antiviral peut être indiqué uniquement pour les formes graves de la maladie. La France dispose d’un traitement antiviral qui a montré son efficacité contre les formes graves du mpox de Clade II qui est disponible à l’hôpital dans le cadre d’une hospitalisation.
14 – Quelle est la stratégie vaccinale des autorités française à ce stade ? est-il recommandé de se faire vacciner ?
Conformément à l’avis de la HAS du 29 août 2024, le MTSS poursuit la vaccination contre le mpox en œuvre depuis 2022 via :
- Une campagne de vaccination en préexposition pour les personnes à haut risque d’exposition :
- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) rapportant des partenaires multiples et les personnes trans rapportant des partenaires multiples ;
- Les personnes en situation de prostitution ;
- Les professionnels des lieux de consommation sexuelle ;
- Les partenaires ou personnes partageant le même lieu de vie que celles à très haut risque d’exposition susmentionnées.
- Une stratégie de vaccination réactive autour des cas pour les personnes contacts à risque telles que définies par SpF ; cette vaccination doit idéalement être administrée dans les 4 jours suivants le contact à risque et au plus tard dans les 14 jours.
Conformément et suite à l’avis de la HAS, les évolutions suivantes sont intégrées à cette stratégie vaccinale :
- Au-delà des personnes contacts à risque d’un cas de mpox, les personnes immunodéprimées ayant eu un contact étroit avec une personne contact à risque sont également éligibles à la vaccination post-exposition ;
- Toute personne dans la cible de la vaccination préventive contre le mpox qui n’a pas été vaccinée depuis 2022 est invitée à initier son schéma vaccinal ;
- Toute personne dans la cible de la vaccination préventive contre le mpox ayant reçu une première dose mais qui n’aurait pas terminé son schéma vaccinal à 2 doses depuis 2022 est invitée à recevoir une dose de vaccin complémentaire ;
- Toute personne dans la cible de la vaccination préventive contre le mpox qui a terminé son schéma vaccinal contre le mpox depuis 2022 est invitée à recevoir une dose de rappel (cela ne concerne pas les personnes vaccinées dans l’enfance qui auraient reçu une dose complémentaire de vaccin depuis 2022) ;
- En cas d’infection entre 2022 et aujourd’hui, aucune vaccination n’est recommandée.
La vaccination est gratuite.
[…]
17 – Combien de doses de vaccins sont nécessaires ?
Le schéma vaccinal comprend 2 doses (ou 1 dose unique pour les personnes ayant déjà été vaccinées contre la variole dans l’enfance, et 3 doses pour les personnes immunodéprimées). La deuxième dose de vaccin doit être administrée dans les meilleurs délais à partir de 28 jours après la première.
La vaccination ne confère pas une protection immédiate, aussi il est important de continuer à éviter tout contact à risque avec une personne infectée par le virus mpox ou suspectée de l’être.
Par ailleurs, il est important de rappeler que quelle que soit l’efficacité du vaccin après une ou 2 doses, celle-ci ne sera jamais de 100%. La vaccination doit toujours restée combinée aux mesures de prévention.
18 – Quelles sont les recommandations pour les personnes s’étant fait vacciné en 2022 ?
Conformément à l’avis de la HAS du 29 août 2024 :
• Toute personne ayant reçu une première dose mais qui n’aurait pas terminé son schéma vaccinal à 2 doses (ou 3 doses pour les personnes immunodéprimées) depuis 2022 est invitée à recevoir une dose de vaccin complémentaire ;
• Toute personne ayant terminé son schéma vaccinal contre le mpox depuis 2022 est invitée à recevoir une dose de rappel (cela ne concerne pas les personnes vaccinées dans l’enfance qui auraient reçu une dose complémentaire de vaccin depuis 2022) ;
• En cas d’infection entre 2022 et aujourd’hui, aucune vaccination n’est recommandée.
La vaccination est gratuite.
20 – Les vaccins sont-ils efficaces et disponibles en nombre suffisants ?
En 2022, lors de l’épidémie de clade II, la vaccination a permis de protéger contre les formes graves de la maladie, cependant elle n’empêche pas 100% l’infection. Pour éviter la transmission du virus, elle doit donc être utilisée en association avec les autres mesures de prévention.
Actuellement, le ministère de la santé dispose de vaccins antivarioliques dits de 3ème génération, en nombre suffisant pour faire face à une épidémie qui se développerait, comme en 2022 sur le territoire national. A ce stade, le risque de développement de l’épidémie est évalué comme faible par l’ECDC.
L’efficacité des vaccins contre le mpox de clade I est en cours d’évaluation par les autorités nationales et européennes, en lien avec le fabricant. Rien ne remet en question à ce stade l’efficacité du vaccin.
Vaccination-info-service, site conçu sous l’égide de Santé publique France, propose un dossier sur les vaccins disponibles pour lutter contre le mpox (variole du singe) (mise à jour du 29/04/25) :
Mercredi 14 août 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché une Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) face à la circulation active d'un nouveau variant (clade Ib) de la Mpox en Afrique Centrale.
Début janvier 2025, un premier cas de contamination par le nouveau variant a été recensé en France.
Pour en savoir plus sur la maladie, vous pouvez contacter Mpox Info Service au 0 801 90 80 69 tous les jours de 8h à 23h (appel et services gratuits, anonyme et confidentiel).
Deux vaccins sont actuellement disponibles contre l'infection à Monkeypox :
Imvanex®
Jynneos®
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Mpox-Variole-du-singe
Le site institutionnel Santé.fr liste les Centres de vaccination dans toute la France :
https://www.sante.fr/recherche/trouver/vaccination%20variole%20du%20singe
SURVEILLANCE SANITAIRE
Santé publique France publie des points de situation très fréquents sur le nombre de cas de mpox détectés en France et dans le monde :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-l-homme/mpox/donnees#tabs
L’OMS propose un bulletin d'information sur les flambées épidémiques à l'échelle mondiale :
https://www.who.int/fr/emergencies/emergency-events/item/2022-e000121
Le Ministère du travail, de la santé et des solidarités répond à la question du risque de pandémie :
10 – Craint-on une pandémie mondiale au même titre que le Covid ?
Comme l’a rappelé le 20 aout 2024 le directeur Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge, « le mpox n’est pas le nouveau Covid ». A date, le risque global pour la population générale de l’UE/EEE est considéré par l’ECDC comme faible.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’épidémie du mpox de Clade I en Europe. Il y a en revanche une épidémie en cours dans plusieurs pays d’Afrique.
COMMENT RESTER INFORME ?
Mercredi 13 juillet [2022], un dispositif d’écoute est ouvert afin de répondre aux questions suscitées par la variole du singe. Subventionné par Santé publique France et portée par SIS Association1, « Monkeypox info service » est accessible tous les jours de 8h à 23h, au numéro vert 0 801 90 80 69 (appel et services gratuits, anonyme et confidentiel
Date de création : 27/07/2022 ; mise à jour : 08/09/2025